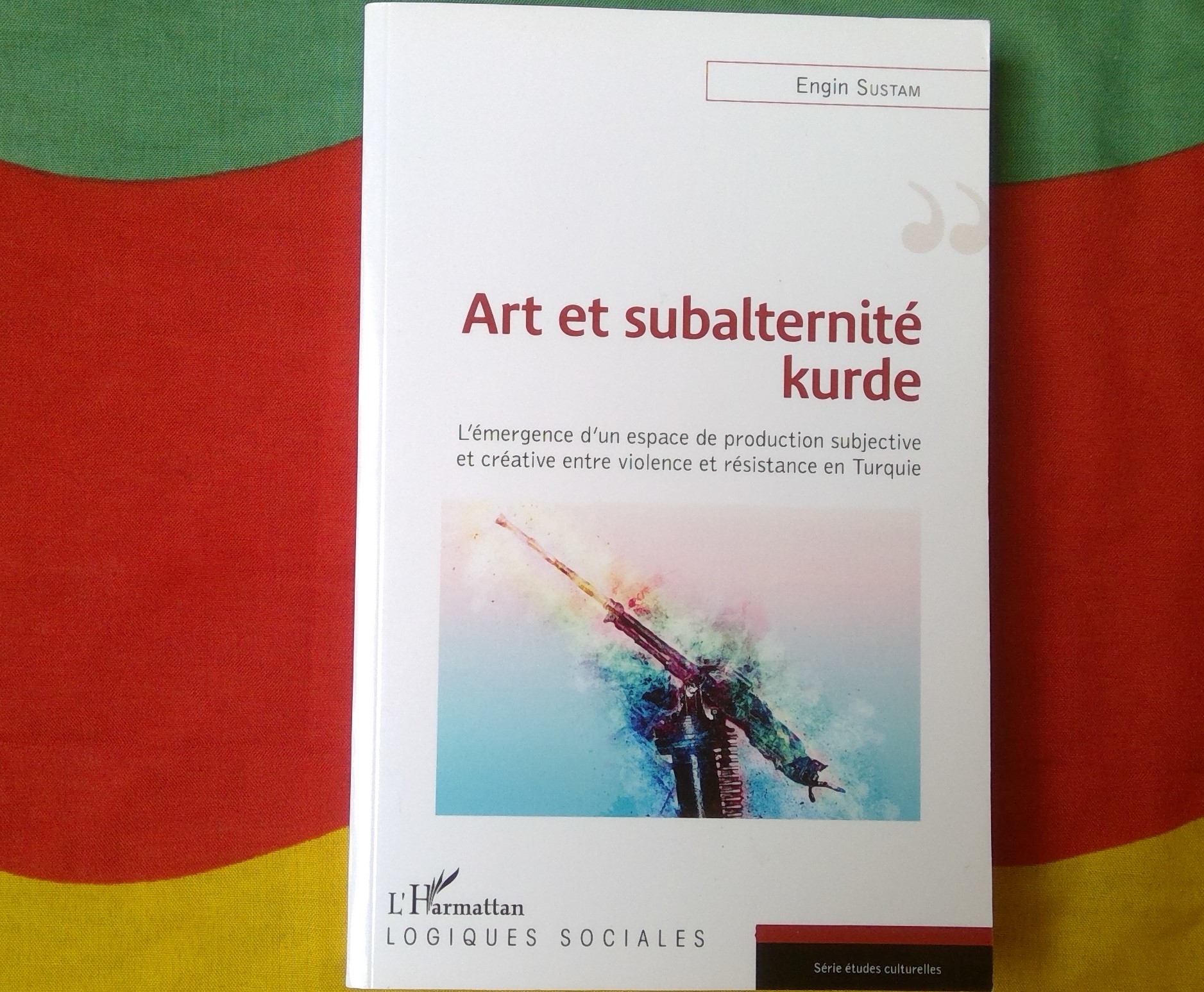« Le motif de la visibilité insurgée et de l’intersubjectivité artistique de l’espace kurde peut être désigné comme la dissociation de la formation politique de l’identité coloniale et des dispositifs étatiques au Moyen-Orient. Je tente de définir une résistance plus créative et l’opposition transgressive de la nouvelle subjectivité kurde en déclinant sur une échelle de positionnement décoloniale. Il est important de comprendre que cela constitue une contre-violence singulière dans la perception créative et une dénonciation de l’impossibilité d’accéder à soi autrement qu’en s’opposant à la violence étatique coloniale, une impossibilité de ne pas pouvoir faire autrement. Cette double injonction, de « double-bind » est une machine dispersée qui présente le dysfonctionnement de la mémoire coloniale dans l’existence kurde. »
Sociologue et critique d’art, Engin Sustam est le seul sociologue kurde connu de l’Occident sous son identité kurde et ses écrits sont importants pour comprendre le champ artistique kurde dans un territoire colonisé nommé Kurdistan. En effet, dans les quatre parties du Kurdistan, les Kurdes vivent sous la domination coloniale perse (en Iran), arabe (en Irak et en Syrie) et turque (en Turquie) où ils sont condamnés à être assimilés à la nation dominante ou disparaitre. Dans son livre « Art et subalternité kurde: L’émergence d’un espace de production subjective et créative entre violence et résistance en Turquie », Sustam analyse attentivement le milieu artistique kurde qui refuse cette injonction avec ses réponses qui sont à la hauteur de cette violence.
Nous avons interviewé Engin Sustam au sujet de l’espace artistique kurde décolonial pour mieux comprendre ses dynamiques actuelles.
« Art et subalternité kurde: L’émergence d’un espace de production subjective et créative entre violence et résistance en Turquie », publié chez Harmattan
« Fruit autant de remarquables enquêtes de terrain que d’une théorisation inventive, l’ouvrage d’Engin Sustam permet de comprendre la formation, par le biais de la création artistique, d’un espace de socialisation, de production de sens et de résistance parmi les Kurdes de Turquie au cours des dernières décennies. Sustam, qui s’inspire nettement de la philosophie et des sociologies politiques, montre que l’art et la littérature ne peuvent répondre à la violence qu’à condition de lui substituer un processus de subjectivation créatrice. » (Hamit Bozarslan)
Voici l’interview d’Engin Sustam:
Engin Sustam, vous êtes sociologue et critique d’art vivant en exil depuis quelques années. Vous avez écrit plusieurs livres, dont « Art et subalternité kurde: L’émergence d’un espace de production subjective et créative entre violence et résistance en Turquie », qui est le sujet de notre discussion d’aujourd’hui.
Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi parle votre livre « Art et subalternité kurde: L’émergence d’un espace de production subjective et créative entre violence et résistance en Turquie » ?
Sustam : Je tiens à vous remercier d’abord de m’avoir donné cette occasion de parler sur mon livre. Alors de quoi parle-t-il ? Depuis l’année 2000, comme vous le savez, l’espace kurde a connu un grand essor, aiguillonné par les transformations sociopolitiques rapides qui bouleversent la subjectivité kurde dans le temps de la mondialisation comme ce qui s’est passé au Rojava en 2012 (écologie sociale, nouvelle constitution, émancipation féminine, etc.) ou encore au Bakûr [Kurdistan “turc”] avant / après l’insurrection urbaine kurde (la municipalité autogérée face à la violence, au totalitarisme et à la guerre) et enfin l’intervention politique contre le corps du régime de violence étatique ou paramilitaire, etc. Je pense que ce type de changement dans l’espace kurde au cours du début du 21ème siècle a donné une énonciation collective assez importante qui a créé à un moment donné la nouvelle subjectivité kurde transfrontalière. Ces nouvelles connaissances de l’espace kurde ne se limitent pas seulement à l’introduction des études politiques kurdes de l’étude kurde, mais donnent ainsi une dimension artistique qui suit le type de nouvelle formation sur l’étude kurde: celles de la création et de la production culturelle sous l’angle de la perspective décoloniale.
Ce livre, issu de ma thèse, a trouvé un chemin assez captivant pour nous faire partager l’expérience décoloniale de l’espace kurde à travers les œuvres d’art. Cet ouvrage est conçu pour analyser tous ceux qui, à un moment de la vie en guerre ou en construction politique au Kurdistan du Nord pour l’avenir, se transforment à travers l’art, le cinéma, le théâtre, la musique ou la littérature anticoloniale à la recherche de l’émancipation micropolitique de l’espace des soulèvements. Je propose ici deux dimensions : l’une est la perception de la résistance dans la création décoloniale, l’autre est l’espace comme un champ politique de contre-violence devenu le vecteur de la visibilité subversive de cette création. C’est la raison pour laquelle, il s’agit de problématiser dans le livre les acteurs de l’espace kurde, qui baignent dans un univers de conflits multimodaux (la violence étatique et la lutte d’émancipation) à une analyse critique de ce qu’ils produisent avec des outils numériques et de création. Cependant, l’intégralité de ce livre ne constitue pas un regroupement de recettes conceptuelles, au contraire, il s’intéresse à questionner la lecture du champ d’art de l’étude kurde que l’on n’a jamais traité avec cette approche décoloniale.
Le but de l’ouvrage est d’inviter constamment au recul critique et à la discussion au sein de l’étude kurde. La problématique est l’approche théorique que j’ai décidé d’adopter pour traiter la question kurde posé par la question de départ, comment peut-on analyser la question kurde à travers de la production de l’espace culturel-insurrectionnel et du champ de l’art à travers une esthétique relationnelle (N. Bourriaud) et décoloniale (Walter Mignolo, Rolando Vázquez). C’est pourquoi je me suis basé sur la question de la décolonialité et de la postcolonialité. Dans un premier temps, la première lacune du livre, j’avais constaté un cadre de changement ontologique qui soit adapté par la construction de la production et de la reproduction qui devient la question centrale de recherche dans l’espace kurde. Comme vous allez voir dans la première partie du livre, cette étape se constitue dans la production du cinéma, du théâtre, de la littérature kurde, de la musique, de la culture populaire kurde et de la gastronomie même se divisant en trois grandes lignes dans la lecture micropolitique sur la mémoire d’une société sans état (Bê Welat). Ici, la subalternité kurde et Bê Welat qui sont les concept centraux du travail, impliquent la singularité insurgée au cœur de la relation bifurquée et traumatisée qu’ils entretient avec la collectivité de la résistance ou de la visibilité insurrectionnelle de l’espace kurde. Concernant la deuxième lacune du livre, elle est bien sûr la lecture décolonisée de l’espace kurde que l’on a défini dans plusieurs dimensions. L’espace kurde comme lieu de la constellation : Subalternité kurde et Nouvelle subjectivité kurde.
Quant au terme de l’espace kurde, il s’agit de problématiser une nouvelle lecture sur la renaissance de la subjectivité kurde qui se concrétise après les années 90. Je définis l’espace kurde comme une constellation méthodologiques pour voir autrement le territoire des Kurdes en quatre patries en plus de la diaspora. L’espace kurde que j’avais nommé comme espace de révolte, de conflit, de violence et de résistance entre deux régimes de valeurs : les micro-langages de l’espace colonisé et le macro-langage de l’espace dominant. Ensuite j’ai mis également un nouvel accent de critique en sciences sociales que vous pouvez consulter dans la première partie, basant sur l’étude décoloniale de Spivak, Bhabha, Mbembe, etc. : la sociologie subalterne. Je considère que, à la suite du déracinement que produit l’exil et la diaspora subit par les Kurdes depuis le début du 20ème siècle, un nouveau type d’intellectuel et d’acteurs apparaît dans l’espace kurde diasporique, souffrant de son aliénation singulière et de l’exil de soi, comme un sans-abri, un précaire de son territoire colonisé. Effectivement, je veux prendre la mémoire vivante de la tradition musicale chez les Kurdes comme celles des Dengbêj (Bardes et conteurs) comme point de départ afin d’analyser la multiplicité du livet et de son espace artistique, culturel kurde. Les Dengbêj sont les acteurs et actrices de l’histoire invisible des Kurdes (de la mémoire orale), qui viennent de façonner le chemin de notre propos décoloniale (Benjamin, Storytellers). A propos des dengbejs, il faut lire le mémoire du master du théâtre d’Aram Taştekin sur la performance théâtrale des Dengbêj qui reflète un travail très sérieux du point de vue théorique et qualitative et en ce qui concerne la recherche sur le terrain à travers les Dengbej importants telles Dengbêj Zahiro, Dengbêj Marûf, Dengbêj Seyitxanê Boyaxçî, Dengbêj Huseyno, Sakiro, Dengbej Reso, etc.
Ceci nous permet d’articuler une analyse des formes de micro-résistance kurde dans une perspective décoloniale de l’ « anomalie » comme « autrui », à partir de la figure rhétorique du zombie et de la monstruosité. Les Kurdes ont été considérés comme une anomalie sociale de la « Turcité ». Cette construction mythique de la modernité colonialiste montre comment nous pourrions décoloniser le savoir de la colonialité. J’envisage ici la figure du « Zombie » comme une approche micro-identitaire des « exclus » kurdes qualifiés de “sauvages”, “barbares”, “créatures étranges” par ses colonisateurs. Alors, en se basant peut-être sur Fanon, on peut dire que la sociologie subalterne de l’espace kurde (de l’invisibilité colonisée à la visibilité subversive décolonisée) correspond bien aux faits politiques de la lutte d’émancipation identitaire dont l’émergence de la conscience politique a remis en cause les termes tels qu’on en discute dans les sciences sociales comme « la reconnaissance, la subalternité, le peuple à venir, la différence, etc. ». Selon moi, cette problématique porte, et à la fois consiste en cette énonciation collective produisant de l’espace insurgé et autogéré, selon des formes de subjectivation issues de la position de subalternité décolonisée (repris même par le mouvement politique kurde) de l’histoire contemporaine des Kurdes.
Alors que la première partie présente des données qui s’inscrivent sous la forme de continuité, de territorialité, d’innovation de la culture décoloniale et de localité insurgée d’une société sans état avec sa visibilité de l’insurrection kurde (Serhildan) et de la lutte identitaire (dès la lutte armée du mouvement politique kurde) ; l’objet de la deuxième partie s’approche de préférence de la forme de la discontinuité avec cela, mais de productivité intergénérationnelle, transfrontalière pour ainsi voir la question politique kurde aux alentours des œuvres d’art contemporain. Foucault dirait ceci « Des espaces autres» (Hétérotopies) comme « un lieu sans lieu » où l’espace met en charge des tensions différentes, des enjeux divers, des formes d’oppositions sans compter le signe de l’État. À partir des interventions subjectives de l’espace des opprimés, l’espace kurde devient affectivement l’agissement d’un contre-pouvoir minoritaire où les Kurdes constituent une zone de résistance transfrontalière mettant l’accent sur la réflexivité décoloniale et l’émancipation territoriale.
A vous lire, on a l’impression de voir un peuple menacé de disparition mais qui s’entête à lutter, créant sans relâche de nouveaux espaces d’existence. D’où vient cet optimisme que vous partagez avec vos compatriotes et dont vous parlez dans vos écrits ?
Sustam : A vrai dire je ne suis pas trop optimiste, mais ni pessimiste. J’essaie de recontextualiser la cause kurde dispersée dans une dimension politique libertaire par le biais de l’art. Mon approche traite de la complexité de l’espace de la révolte qui engendre une nouvelle perception politique et un nouveau champ artistique par le biais du contre-pouvoir et de la reproduction contre-culturelle, qui donne à voir visiblement en dehors du comportement étatique. Par exemple, jusqu’ici on ne peut pas parler d’une perception artistique de l’espace kurde, on est considéré toujours comme artiste turc, perse, arabe ou d’autre, comme le disait Hamit Bozarslan dans “le Conflit kurde : Le brasier oublié du Moyen–Orient”. Mais aujourd’hui, nous pourrons parler assez visiblement des actrices et acteurs d’un espace artistique kurde. Lorsque je vois toutes ces nouvelles productions en cinéma, en musique, en théâtre, en art contemporain et en littérature, on a une archive énorme à consulter autrement. Ceci me donne en effet ce sentiment positif. Si j’ajoute encore, la pathologie ou le traumatisme de l’espace kurde permettent également de lever le vecteur de la blessure, de la tragédie sociale et de la réalité dans la production artistique comme au cinéma kurde, et deviennent à vrai dire un langage de micro-résistance de la nouvelle subjectivité kurde dans la pensée décolonisée. Cette réflexion est à rattacher parfois au principe de la rhétorique de l’aliénation identitaire, mais aussi de la reconstruction micro-identitaire narrative et repose sur le reflet de l’altérité kurde insurgée. De cette histoire surgissent des formes de résistance plus créatives et des arts qui héritent de la pensée anticoloniale, en produisant de nouvelles formes de subjectivité qui se déclinent sur une échelle de positionnement décoloniale à travers les nouveaux répertoires associés à l’insurrection urbaine kurde qui change les codes de cet espace et se transforme dans cet espace.
À l’introduction du livre, j’avais considéré l’espace kurde comme un lieu de révolution moléculaire. C’est une notion développée par Félix Guattari dans les 1970 pour analyser le changement social et les nouveaux espaces de liberté (avec A. Negri) qui ne font référence ni une révolution nationale ni une révolution prolétarienne mais une révolution qui contient plusieurs éléments du territoire, de la vie, du contexte. Ce lieu de passage de l’altérité insurgée et du contexte conflictuel englobe des maintes tendances hétérogènes, articule un aperçu politique d’espace kurde dans une grammaire de « rapports de forces de l’énonciation » proche de celle que développe Félix Guattari, « une révolution moléculaire » au sein d’une nouvelle subjectivité kurde qui met l’accent d’une part, sur l’omniprésence des lieux de l’art et ainsi de l’autre, de la révolte et de l’écosystème. C’est pourquoi j’ai démonté l’espace kurde à plusieurs éléments moléculaires (à l’entrée du livre) dans les changements survenus. En ce sens, j’avais tenté d’associer des concepts comme ‘appartenance, alternance, déviance, reterritorialisation, constellation, biopolitique, etc.’ dans une interprétation transdisciplinaire pour repenser les faits politiques, la culture, la révolution, l’identité, la géographie, le territoire qui influencent les modules de l’espace kurde. J’observe une transformation des facteurs sociopolitiques qui sont devenu le lecteur principal de l’espace kurde pour créer sa visibilité constitutive : Révolte, Révolution, Institution et subjectivité minoritaire en dynamique. Enfin, ces quatre facteurs sont certainement un des meilleurs véhicules pour saisir la nouvelle subjectivité kurde dans l’espace du conflit.
Je voudrais parler d’une future exposition qui s’attache à votre question. Donc, je serai prochainement curateur d’une exposition avec notre équipe KARGEH (avec Sener Özmen, Bilal Ata Aktas, et nos amies Duygu Örs co-curateur et Elif Küçük-Directrice artistique) qui se réalisera à NGBK Berlin intitulant “Bê Welat – Unexpected Stroytellers” [Bê Welat signifie « sans patrie » en kurde]. Bien entendu, ces éléments et cette exposition importante permettent d’incarner non seulement l’image créative positive de l’espace kurde, mais l’ensemble des médiations symboliques de l’espace kurde.
Si vous me permettez, j’aimerais élargir votre question avec l’analyse de l’œuvre d’art de certains artistes comme l’œuvre Road to Tate Modern de Sener Özmen et Erkan Özgen, qui relate bien votre question dans un optimisme d’ironie politique et qui est à la recherche de l’imagination artistique du musée Tate Modern à Londres dans la zone de guerre au Kurdistan du Nord. Cette vidéo installation est une parodie de Don Quichotte (homme de vertu, Sener Özmen) avec son compagnon Sancho Panza (homme fidèle, Erkan Özgen), qui se déroule dans leur étroite province, celle de Mardin. Dans cette parodie, Sener Özmen et Erkan Özgen critiquent, avec l’absurdité et l’humour (et des dialogues adaptés en kurde), l’espace artistique dominant, en mettant en scène un homme animé de ressentiments (Don Quichotte) à la recherche du palais d’exposition « Tate Modern» (symbolisation des Moulants) de Londres. J’avais nommé cette vidéo dans le livre comme “Don Quichotte héros mondialisé de l’errant”. Enfin, les deux personnages déterminent réciproquement le sens de leur aventure. Dans un deuxième temps, nous pouvons remarquer que les costumes sont ceux des fonctionnaires de l’éducation nationale turque, ils sont déjà enseignants. Avec ces costumes, les artistes reflètent l’absurdité réflexive en rappelant qu’ils viennent de l’école pour réaliser spontanément cette vidéo installation.
Après leur repos, Sancho demande à son seigneur en kurde, s’ils ont perdu la route de Tate Modern dans les montagnes : « Seigneur qu’est-ce que vous pensez ? Quel chemin doit-on poursuivre pour Tate Modern ?». Puis, ils rencontrent un villageois qui descendait de la haute montagne. Sancho prend alors de nouveau la parole au lieu de son seigneur : « Bonjour mon frère, tu es d’où ? D’où tu viens ? Je voulais te demander le chemin de Tate Modern que l’on a perdu. Nous sommes sur la route depuis 40 jours et nuits. Comment peut-on trouver la Tate Modern, mon frère ?». Le villageois répond : « je viens d’en haut, je descends en bas. C’est par là jusqu’aux montagnes vous continuez (le signe d’une impossibilité colonisée) ». Sancho : « C’est loin ces montagnes ». Le villageois : « Oui, c’est loin, assez loin ». Sancho se retourne vers son seigneur : « Seigneur, il dit que le chemin de Tate Modern est sur la gauche. C’est par là que l’on doit y aller et c’est assez loin ». Le Don Quichotte « kurde » parle, armé de son conformisme à toute épreuve, et s’enferme dans sa schizophrénie (l’artiste répète ici les dialogues et le discours du vrai Don Quichotte par la vertu stoïque, le geste et les mots courts d’un Don Quichotte capricieux qui n’écoute jamais son compagnon). Tout récit chevaleresque évoque l’aliénation d’un personnage fou ; héritage littéraire que la vidéo prolonge à sa manière dans la critique décoloniale.
La vidéo invite au rire et à la vigilance critique face à une intention subversive artistique kurde. L’ironie de la démarche vidéographique ridiculise les lignes de fracture de la géographie, et du paysage rurale en imaginant l’espace urbain de Tate Modern. Ils faisaient alors un rapprochement entre le musée « Tate Modern » et les démons combattus par Don Quichotte qui sont les clés de la société coloniale excluant les Kurdes. La figure errante de Don Quichotte dessine aussi leurs identités colonisées des artistes dans les montés des montagnes du Kurdistan (dans le champ de l’art en Turquie), comme le destin de leur peuple opprimé. Par ailleurs, ils ont traîné leur cheval et leur âne vers un point qui révèle métaphoriquement les difficultés subjectives de leur propre ascension d’être kurde. Vous pourriez consulter cette perspective dans les autres œuvres d’art comme celles de « Stones to throw, Mutual Issues- Inventive Acts » d’Ahmet Ögüt, « Free Kick » de Cengiz Tekin, « Tinica » de Fikret Atay, « Stop ! You are surrounded » de Berat Isik, « Adults Games » d’Erkan Özgen, etc. Je pense que j’ai cet optimisme politique de Don Quichotte errant.
Dans votre livre, vous parlez d’un espace artistique kurde prolifique où la contestation et l’affirmation identitaire kurde défient la politique d’assimilation menée par l’État colonialiste turc depuis près d’un siècle maintenant. Toutefois, on sait que cette contestation/affirmation identitaire kurde ne se fait pas sans douleur. Comment cela se traduit dans la création artistique kurde ?
Sustam : Tout d’abord, je dirai que je ne parle pas d’un art politique engagé mais d’un art décoloniale qui se positionne depuis les œuvres face à la gouvernementalité nécro et biopolitique. Je pense que cette démarche permet d’identifier aisément les processus de canonisation politique des artistes kurdes dans le milieu de la colonisation, par exemple à Diyarbakir, et dans l’absurdité territoriale de la guerre.
Le processus de la lutte et du conflit se manifeste donc sous la forme d’un “ressentiment” et entraîne certaines réactions physiologiques ou psychologiques que l’on retrouve dans l’écriture, l’image vidéographique, le cinéma, la musique et finalement dans l’art contemporain en fonction de l’intensité de l’angoisse ressentie par les artistes de la génération de la guerre. En effet, il y a des artistes engagés dans cette question politique directe. Comme le travail virtuel de l’artiste de la nouvelle génération Zehra Dogan qui a fait cet engagement après le bombardement de la ville de Nusaybin par l’armée turque. Elle a dessiné sur son smartphone une image de Nusaybin complètement rasé par l’armée turque qui circulait sur les réseaux sociaux.
Dans le changement macro politique, nous observons un changement de mémoire de la référence à l’espace et l’émergence d’une perception singulière qui s’exprime à travers l’intermédiaire de la prise de l’art dans la conscience politique en devenir. Dans ce contexte, ce livre a questionné la juxtaposition des artistes et de la question artistique kurde ainsi en croisant l’ambition théorique avec le souci de l’enquête empirique, la souffrance de la subjectivité kurde et la prise de distance à l’égard de l’identité coloniale pour saisir d’une manière différente la posture sous les pavés du terrain.
Tant que les artistes et acteurs parlent eux-mêmes de l’impossibilité de ne pas être au-dedans et au-dehors de la question dans une approche « entre-deux », interstitielle. En effet, je propose ainsi deux dimensions : l’une est la perception de la résistance dans la création, l’autre est l’espace comme un champ politique de contre-violence devenu vecteur de création. La création contribue à élargir les frontières de l’action et de la contre-violence face à la violence étatique, ou encore symbolique. En outre, la création contribue à repenser la question politique kurde de nouveau.
Aucun auteur n’a traité à ce jour le corpus issu de l’espace kurde au Moyen-Orient ou en diaspora de ce point de vue culturel, artistique (la minorité sans État en devenir). Ce livre, si vous voulez, souhaitait analyser les éléments qui instaurent cette transgression de la nouvelle subjectivée kurde, non seulement visible dans la production par la création comme motif iconographique de politique social, mais aussi vécue par les acteurs et artistes de cet espace.
Je me rappelle de notre interview avec l’artiste et écrivain Sener Özmen en 2008 à Diyarbakir. Il disait : “On ne fait pas de l’art, on raconte une histoire déchirée, schizophrénique de l‘époque, des villages incendiés et des disparus. Nous sommes au milieu de la guerre avec notre art, c’est pour ça que vous ne pouvez pas nous demander de faire des peintures idylliques alors que l’on vit sous les bombes et dans la réalité de la guerre.” En effet, je pourrais continuer avec l’exemple des œuvres d’art. Les œuvres « Adult Games » d’Erkan Özgen (vidéo, 2003) et « Our Village » de Sener Özmen (vidéo, 2004) donnent la référence du trauma et du post-trauma sur le corps enfantin qui a subi la violence, le conflit et la pathologie politique de la guerre comme celle de la vidéo « Şiryan » de l’artiste Fatoş Irwen qui vient de sortir de la prison.
Ces artistes montrent la réalité vécue dans une imagination conceptuelle de fiction et font parler le corps féminin et enfantin traumatisé. La vidéo « Our Village » propose un regard humoristique sur les émotions quant au changement du climat social dans la région kurde (telles les quatre saisons : printemps, été, automne et hiver) où les enfants subissent ces changements climatiques tels des traumatismes, une pathologie névrotique sous la pression de la violence étatique. Mais ce climat n’est pas celui du temps, c’est le climat de la réalité sociale, de la question kurde comme cadrée en quatre saisons par la construction de la gouvernementalité nécropolitique, et correspond à la condition atmosphérique de la politique de la guerre.
Par exemple, l’artiste Fatos Irwen essaie ainsi de questionner l’espace masculin et la domination militaire patriarcale dans l’espace kurde à partir de l’utilisation de son corps qui devient une machine de lutte. Sa vidéo « Patolojik Hafıza» (Mémoire pathologique) issue du biais des tabous sexués et de la représentation des femmes kurdes au Kurdistan. L’artiste critique avec un humour politique la pratique de la sexualité dans la culture patriarcale au Kurdistan et démontre la position de la valorisation sexiste dans l’histoire étatique.
Irwen emploie bien la réflexion de son corps, de ses cheveux et la performance corporelle dans ses œuvres. Dans cette perspective, les artistes problématisent bien leur réflexion autour de la question politique dans l’espace kurde, mais si vous voulez ils ne sont pas militant d’une approche idéologique. Cependant leur œuvre réunit tous les éléments de la question politique et s’attache spontanément à la conscience politique et nationale.
Cette approche cherche à rendre compte des reconstructions autoréférentielles des Kurdes concernant la perception qu’ils se font de la réalité historique ou du sentiment d’être « sans-patrie » (Bê Welat) comme une société sans Etat. Plus précisément, on observe également le changement de l’identité militante (de « homo politicus à homo poeticus ») et l’émergence d’une réflexion intellectuelle qui s’exprime à travers la littérature, la productivité culturelle, artistique comme le cinéma kurde qui est assez politique, mais pas une approche de film politique (même s’il y a des réalisateurs qui font le film politique, comme Kazim Öz et Ömer Leventoglu par exemple).
L’espace kurde décrit le changement d’attitude politique des acteurs socio-nationaux, qui utilisaient dans les années 1970 des techniques « disciplinaires et propagandistes » sous l’influence fanonienne et marxiste. Ce changement traduit en effet une vision nouvelle par exemple dans la littérature kurde contemporain. Effectivement, il faut voir les écrits littéraires de Yaqop Tilermenî, de Kawa Nemir, de Renas Jiyan, de Sener Özmen, de Ciwanmerd Kulek, etc. Autrement dit, la réflexion artistique kurde soulignent une perception politique de l’expérience de ne pas écrire autrement.
En dehors de tout cela, selon moi, le motif de la visibilité insurgée et de l’intersubjectivité artistique de l’espace kurde peut être désigné comme la dissociation de la formation politique de l’identité coloniale et des dispositifs étatiques au Moyen-Orient qui pourrait conclure votre question. Je tente de définir une résistance plus créative et l’opposition transgressive de la nouvelle subjectivité kurde en déclinant sur une échelle de positionnement décoloniale. Il est important de comprendre que cela constitue une contre-violence singulière dans la perception créative et une dénonciation de l’impossibilité d’accéder à soi autrement qu’en s’opposant à la violence étatique coloniale, une impossibilité de ne pas pouvoir faire autrement. Cette double injonction, de « double-bind » est une machine dispersée qui présente le dysfonctionnement de la mémoire coloniale dans l’existence kurde.
Engin Sustam a terminé ses études de premier cycle en sociologie à l’Université des beaux-arts Mimar Sinan (2000) et a obtenu son diplôme de maîtrise dans la même faculté (2002). Il a ensuite obtenu un autre master (DEA, 2005) et son doctorat (2012) à l’EHESS, département de sociologie. Il a ensuite travaillé en tant que professeur de philosophie et de sociologie à temps plein en Turquie. Il est actuellement chercheur associé à l’IFEA d’Istanbul et a été chercheur invité à l’Université Queen Mary de Londres, à l’Université de Genève, à l’EHESS, à la FMSH, à l’ENS et à l’Université Paris 8. Ses principaux intérêts incluent, entre autres, « les soulèvements, l’art, la perspective décoloniale dans l’espace kurde et l’écologie sociale ». Il s’est récemment concentré sur la violence et le système post-totalitaire. Il a activement collaboré avec des chercheurs de plusieurs autres disciplines des sciences sociales, notamment la philosophie politique et la psychanalyse. Les domaines de recherche de Sustam comprennent la microsociologie, les études de sous-culture et l’analyse postcoloniale dans la littérature, les arts et la production culturelle. Il est l’auteur du livre « L’art kurde et la subalternité, l’émergence d’un espace de production subjectif et créatif entre violence et résistance en Turquie », publié par l’Harmattan en septembre 2016 et « l’insurrection imprévue: les soulèvements mondiaux » publiéen turc par la maison d’édition Kalkedon Istanbul qui sera traduit et publié en français. Il est commissaire d’exposition et critique d’art contemporain pour la micro-politique, la culture décoloniale et la mémoire. Il est membre du comité de lecture de la revue de sciences sociales « Teorik Bakis » (Istanbul), Cetobac EHESS et de l’équipe InCite de l’Université de Genève. Il travaille actuellement sur un projet dexposition de l’art contemporain à NGBK Berlin : « Bê Welat- Unexpected Storytellers » avec le groupe KARGEH et une équipe berlinoise qui réalisera en été 2021.