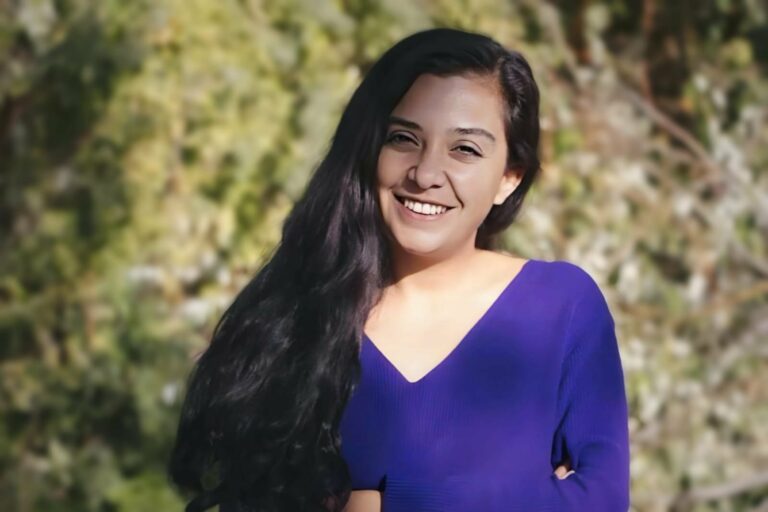TURQUIE. Acquittement d’une journaliste kurde poursuivie pour « insulte »
TURQUIE. Deux cinéastes kurdes condamnés à la prison pour « propagande terroriste »
Kurdophobie et islamisme en Syrie…
MIGRATION. En une semaine, 4 réfugiés kurdes morts en Europe
On signale qu’il y a deux réfugiés kurdes parmi les cinq morts lors du naufrage de leur embarcation au large de Wimereux (Pas-de-Calais), en France, dans la nuit dans la nuit de lundi 22 à mardi 23 avril, alors qu’ils tentaient de traverser la Manche pour se rendre au Royaume-Uni.
Le cardiologue kurde licencié par le régime turc, Salaheddin Akçay, est décédé d’une crise cardiaque sur les rives du fleuve Evros, en Grèce, alors qu’il tentait de se rendre en Europe.
Mehmet Sait Polat (photo), un réfugié kurde originaire du Diyarbakir / Sur arrivé en Allemagne il y a 9 mois, a mis fin à ses jours à Erfurt, où il résidait.
TURQUIE. 30 civils kurdes raflés à Mardin / Kiziltepe
TURQUIE / KURDISTAN – 30 civils ont été arrêtés dans le district Kizilitepe de la province kurde de Mardin.
Les forces de l’État turc ont terrorisé la population kurde lors de perquisitions menées à Kızıltepe ce matin.
Selon les dernières informations, une trentaine de personnes ont été arrêtées.
On apprend que les arrestations ont été effectuées sous l’accusation arbitraire et systématique de « faire de la propagande pour une organisation illégale », à savoir le PKK.
Commémorations des martyrs de la révolution du Rojava
Le Département d’État américain signale que mercenaires de la Turquie ont commis des crimes de guerre en Syrie
IRAN. Inquiétudes pour la vie du rappeur kurde Saman
IRAN. Les mollahs tentent de faire taire les journalistes en les emprisonnant
IRAN. Le rappeur Toomaj Salehi condamné à mort
IRAN – Le rappeur Toomaj Salehi condamné à mort pour avoir chanté des chants de protestation lors de la révolution « Femme, vie, liberté » (Jin, jiyan, azadî) déclenchée par le meurtre de Jina Mahsa Amini, une jeune Kurde de 22 ans à cause d’un voile « non conforme » à la charia islamique.
« Le tribunal révolutionnaire d’Ispahan (…) a condamné Toomaj Salehi à la peine de mort pour corruption sur Terre », a déclaré Amir Raisian, l’avocat de l’artiste.
Toomaj ou Tomaj, de son vrai nom Toomaj Salehi est un rappeur kurde de Lorestan très célèbre. Dans ses textes, il évoque les problèmes de la société iranienne et les mobilisations contre la République islamique.
Le mercredi 24 avril 2024, Amir Raiesian, l’un des avocats de la défense de Toomaj Salehi, a déclaré dans une interview accordée à Shargh Channel que « Le tribunal révolutionnaire d’Ispahan, dans un contexte sans précédent. décision, n’a pas appliqué le verdict de la Cour suprême sur l’affaire Toomaj Salehi de 2022, et ainsi, en interprétant cette décision comme une « statue du Directoire » et en soulignant l’indépendance du tribunal de première instance, a condamné M. Salehi à l’exécution pour corruption sur terre.
Le tribunal révolutionnaire d’Ispahan a considéré les allégations de partenariat dans la rébellion, de consensus et de collusion, de propagande contre le gouvernement et d’incitation à l’émeute comme des cas de corruption sur terre en vertu de l’article 286 du Code pénal, et sur la base de ces présomptions et soulignant l’authentification de la corruption, il a prononcé la condamnation à mort de M. Salehi. Ceci malgré le fait que la même branche n’avait pas confirmé auparavant l’authentification de l’accusation de corruption sur terre. Cependant, plus étrangement encore, le tribunal de première instance a également envisagé une peine supplémentaire parallèlement au verdict d’exécution et a condamné Toomaj Salehi à deux ans d’interdiction de voyager, d’interdiction d’activités artistiques et de participation à des cours d’amélioration des compétences comportementales organisés au centre judiciaire d’Ispahan ».
Salehi avait déjà été condamné par la même branche du tribunal à six ans et trois mois d’emprisonnement et à une interdiction de voyager à titre de peine supplémentaire pour des allégations de « corruption sur terre ». Salehi avait été acquitté des allégations d’« insulte à Khomeiny », d’« insulte à Khamenei » et de « communication avec des États hostiles ».
Après avoir enduré un an et 21 jours d’emprisonnement, dont 252 jours en isolement cellulaire, et après avoir annulé la peine de six ans et trois mois d’emprisonnement par la 39e chambre de la Cour suprême, le 18 novembre 2023, Toomaj Salehi a été temporairement libéré. de la prison centrale d’Ispahan en attendant la fin de son procès.
Salehi a été arrêté le 30 octobre 2022, au milieu des manifestations du mouvement Femme, Vie, Liberté dans le village de Gerd Bisheh, district de Gandoman, comté de Borujen, province de Chaharmahal et Bakhtiari.
Cet artiste a été arrêté pour la deuxième fois le 30 novembre 2023 par les forces de sécurité armées de la ville de Babol de manière violente et battue. Depuis, il a été transféré au centre de détention de Dastgerd, dans la ville d’Ispahan, où il est actuellement détenu.
KURDISTAN. Talabani répond aux menaces d’Erdogan en honorant un héros tombé au Rojava
« Les Kurdes à nouveau harcelés »
Le Parti de la gauche européenne, une association de 40 partis, a condamné les perquisitions du 23 avril dans les locaux de Stêrk TV et Medya Haber à Bruxelles. Le parti appelle « les institutions politiques européennes et les organismes de presse dévoués à la préservation des principes démocratiques » à se joindre à eux pour s’opposer aux attaques. L’association a également demandé des explications aux autorités belges.
L’association, composée de 40 partis, a dénoncé le fait que ces raids coïncidaient avec la Journée du journalisme kurde et a souligné que l’incident s’était produit peu de temps après la visite du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan en Belgique. Les membres du parti ont déclaré que le moment choisi pour les raids « soulève de sérieuses inquiétudes quant à la collaboration intergouvernementale visant à étouffer la voix kurde. C’est un écho désolant de la violence d’État qui est une réalité de longue date pour la presse d’opposition en Turquie. »
La Gauche européenne a souligné le rôle vital des médias kurdes dans la lutte contre le discours sur l’État turc. Ils ont écrit : « Les médias kurdes jouent un rôle indispensable en fournissant des informations et une plateforme d’expression pour des millions de Kurdes, en particulier ceux du Rojava [régions autonomes du nord et de l’est de la Syrie dirigées par les Kurdes] et du Rojhilat [régions à majorité kurde d’Iran], qui compter sur des médias comme Sterk TV au milieu des conflits en cours et des pressions politiques. Les mesures prises contre ces voix médiatiques ne peuvent être justifiées par aucun motif raisonnable et menacent le cœur même des valeurs démocratiques que nous, le Parti de la gauche européenne, défendons fermement. »
Le parti a exprimé sa solidarité avec les journalistes touchés par les perquisitions et a demandé des explications aux autorités belges. Ils ont appelé « toutes les institutions politiques européennes et les organes de presse dévoués à la préservation des principes démocratiques à se joindre à nous pour condamner ces actions ».
Voici le communiqué commun du NPA (France) et de la Gauche anticapitaliste (Belgique)
Les Kurdes à nouveau harcelés
Le matin du mardi 23 avril, sur instruction du Parquet anti-terroriste français, la police belge a procédé à une perquisition destructrice dans les locaux des télévisions kurdes à Denderleeuw, emportant les ordinateurs, sectionnant les câbles et empêchant de fait la reprise des émissions. Dans le même temps, la police française perquisitionnait les domiciles de militantEs kurdes ou franco-kurdes en région parisienne et dans les Bouches-du-Rhône, et 9 personnes ont été placées en garde à vue.
Ce sont donc encore fois les Kurdes, celles et ceux qui luttent pour le confédéralisme démocratique et se sont sacrifiéEs dans le combat contre Daesh qui sont harcelés et emprisonnés. Le régime turc mène actuellement une violente offensive en Irak, menace le Rojava, emprisonne et destitue les maires démocratiquement élus, mais c’est contre les Kurdes que le gouvernement français s’acharne, pour satisfaire le président turc Erdogan et sans doute pour de sordides raisons de business. La France expulse vers la Turquie des militantEs kurdes qui se sont réfugiés en France pour échapper aux persécutions et à la prison, au mépris du droit international.
Nous serons toujours aux côtés des camarades kurdes dans leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits démocratiques fondamentaux.
Stop au harcèlement des militantEs kurdes en France, en Belgique, et ailleurs en Europe !
Retrait immédiat du PKK de la liste des organisations terroristes !
Libération de tous les prisonniers politiques en France et en Turquie !
Solidarité avec le Rojava menacé d’invasion !
Le mercredi 24 avril 2024