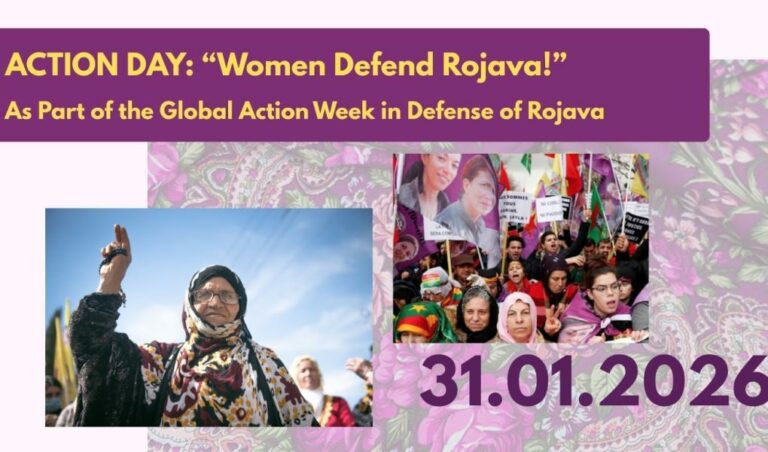SYRIE / ROJAVA – L’Association des femmes journalistes kurdes (ROJIN) a publié un communiqué sur la situation dans le nord et l’est de la Syrie. Elle y condamne l’incitation à la violence dans la presse régionale et le manque de couverture médiatique internationale.
L’Association kurde des femmes journalistes (ROJIN) déclare que la presse arabe et turque, par sa propagande de guerre et ses arguments religieux, sexistes et nationalistes, attise la haine entre les peuples, fait preuve de misogynie et se rend ainsi complice de génocide. S’adressant aux médias internationaux, la ROJIN les appelle à respecter la déontologie journalistique et à « répandre la vérité ». Les journalistes critiquent notamment le fait que le siège du Rojava, les déplacements forcés, les enlèvements et les exécutions, la crise humanitaire et les actes de torture lors des funérailles soient ignorés, et que les reportages soient fragmentaires et incomplets.
« Des femmes enlevées par des gangs comme butin de guerre » : voilà qui mérite l’attention. « Kobanê, ville qui a mis fin aux agissements barbares de Daech en 2015 et offert au monde une grande victoire » : voilà qui mérite l’attention. « Les Kurdes du Rojava, menacés de génocide, de famine et de déplacement forcé » : voilà qui mérite l’attention. Diffuser ces informations auprès du public est la responsabilité éthique, professionnelle et morale des médias internationaux.
ROJIN les invite donc à se rendre dans les zones assiégées pour constater les faits par eux-mêmes et en rendre compte de manière impartiale. Le communiqué de l’association se poursuit :
Des crimes de guerre ont été commis
« En tant que presse kurde libre et médias féminins kurdes, nous suivons les attaques génocidaires qui ont débuté le 6 janvier à Alep et se sont propagées dans tout le nord-est de la Syrie, avec l’aide de dizaines de journalistes et de médias sur le terrain, et nous essayons d’informer le public mondial avec des images, des photos, des informations et des documents.
Les images et les documents provenant de la région ont non seulement une valeur informative, mais confirment également des crimes de guerre.
Le corps de Deniz Çiya, membre des Forces de sécurité intérieure du Nord et de l’Est syrien (Asayîş) à Alep, a été jeté du troisième étage d’un immeuble par des milices de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et des milices soutenues par l’État turc, aux cris d’« Allahu Akbar ». La mutilation de cadavres est considérée comme un crime de guerre en vertu des traités internationaux. Ces mêmes milices ont forcé la population d’Alep à fuir, ont enlevé des dizaines de personnes, en ont assassiné certaines et ont incendié leurs maisons.
Massacres de la population civile et enlèvements
Le 20 janvier, les mêmes milices ont enlevé deux combattantes des Unités de protection des femmes (YPJ), Amara Intiqam et Narîn Axîn, dans la région de Deir ez-Zor. Elles les ont forcées à parler, les ont filmées et les ont traitées comme du butin.
Le 22 janvier, des mercenaires barbares ont assassiné cinq membres de la famille Salih, qui tentaient de fuir Raqqa pour Kobanê, et le 27 janvier, l’avocat kurde Silêman Ismail, qui tentait également de fuir Raqqa pour Kobanê.
Siège et catastrophe humanitaire
Alors que ces exécutions et crimes de guerre se poursuivaient, de nombreuses régions du Rojava étaient assiégées. En raison du siège de Kobanê, l’approvisionnement en produits de première nécessité tels que l’eau, l’électricité, la nourriture et les soins médicaux n’est plus garanti.
La crise humanitaire s’aggrave. Cinq enfants sont morts à Kobanê suite à des coupures de courant et au manque d’oxygène. Des dizaines de milliers de personnes contraintes de fuir ont trouvé refuge dans différentes régions de Kobanê et du Rojava. En raison du blocage des frontières, l’aide humanitaire collectée n’atteint pas la région.
Les médias arabes et turcs complices de crimes de guerre
Tout au long de ces crises humanitaires et attaques génocidaires, certaines chaînes arabophones comme Al Arabiya , Al Hadath et Al Jazeera , ainsi que les médias turcs, ont présenté les morts civiles et la crise humanitaire comme une victoire.
De la même manière que les mercenaires considèrent les femmes comme des « proies » et des « servantes », les transformant en ennemies, les chaînes de télévision arabes diffusent des messages sexistes et haineux. Parallèlement, le lobby médiatique turc, qui légitime les attaques génocidaires d’Alep à Kobané, se rend complice de ces crimes par le biais de diffusions orchestrées et de propagande de guerre. Les médias dominants, qui qualifient tous les Kurdes d’Alep et du Rojava de terroristes, ont pris pour cible tous les Kurdes de la région et ont glorifié la guerre, la mort, les massacres et le génocide. Ces crimes sont documentés quotidiennement dans les journaux, les émissions de télévision et les médias numériques, et constituent des crimes de guerre.
Les médias comme partie belligérante
Toutes ces publications destructrices confirment une fois de plus que les médias, qui devraient informer au nom de la paix et de la liberté, dans l’intérêt public et des valeurs démocratiques, sont devenus complices de la guerre. Nous dénonçons ces organes de presse, qui diffusent des informations militaristes, nationalistes, religieuses et sexistes et glorifient la guerre, la mort, la famine et la destruction, et nous appelons l’ensemble du public à les boycotter.
Réaction au traitement « sélectif » de l’information par les médias internationaux
Certains médias internationaux ont choisi de couvrir les événements du Rojava de manière sélective. Ils ont passé sous silence le génocide, les exécutions de civils, la crise humanitaire et les déplacements forcés de population dans la région, préférant les présenter comme un « conflit entre deux puissances ». Le seul sujet qui a retenu l’attention de la presse internationale était « le sort des membres de l’EI emprisonnés ». Des questions telles que les sièges utilisés comme méthode de guerre, les enfants morts de froid, la profanation des cadavres de femmes, les enlèvements et l’existence de milices devenues des armes de destruction massive ont été jugées sans intérêt.
Nous appelons les médias internationaux à respecter la déontologie de la presse et les valeurs journalistiques et à avoir le courage de partager les faits avec le public sans pression gouvernementale.
La responsabilité éthique, professionnelle et morale de la presse
Nos collègues journalistes kurdes rendent compte des conflits en fournissant images, documents, informations et photos, au péril de leur vie. Nous appelons les médias internationaux à respecter ce journalisme, exercé avec la conscience et le souci de diffuser la vérité, et à rendre compte de manière à mettre fin aux attaques génocidaires et à informer le public avec exactitude.
Les enfants morts de froid pendant le siège méritent d’être mis en lumière. Les femmes enlevées par des bandes criminelles et réduites en butin méritent également l’attention du public. La bataille de Kobanê en 2015, qui a mis fin aux agissements barbares de Daech et offert au monde une grande victoire, est un événement digne d’intérêt. Le sort des Kurdes du Rojava, contraints à l’exil par le génocide, la famine et les déplacements forcés, mérite lui aussi l’attention. Communiquer ces faits au public est la responsabilité éthique, professionnelle et morale des médias internationaux.
Nous vous invitons à vous rendre dans les zones assiégées pour constater les faits par vous-même et en rendre compte de manière impartiale.
Nous continuerons à défendre la vérité.
En tant que médias kurdes libres, qui avons sacrifié des dizaines de vies pour la vérité depuis les années 1990, nous considérons qu’il est de notre devoir moral de couvrir en direct les attaques génocidaires dont notre peuple est victime au Rojava. Nous continuerons à partager la vérité sans détour avec le public, à dénoncer les crimes dissimulés et à informer la population en temps opportun.
Nous continuerons à défendre les valeurs démocratiques, la coexistence et la vérité contre le fondamentalisme exacerbé, le nationalisme, le sexisme et le militarisme, et à rappeler aux gens le langage de la paix. » (ANF)