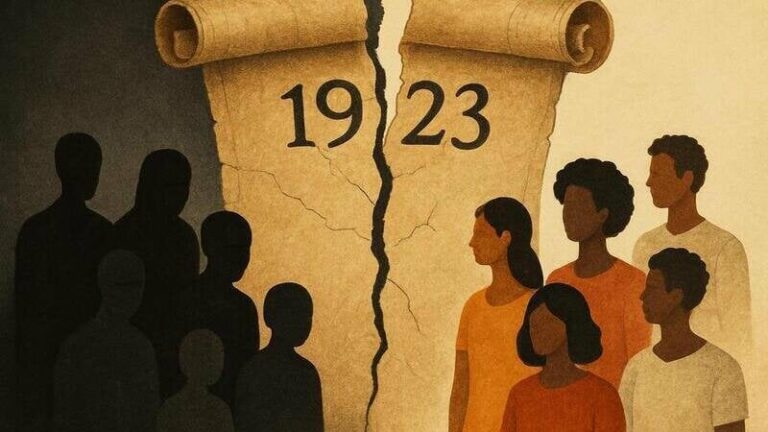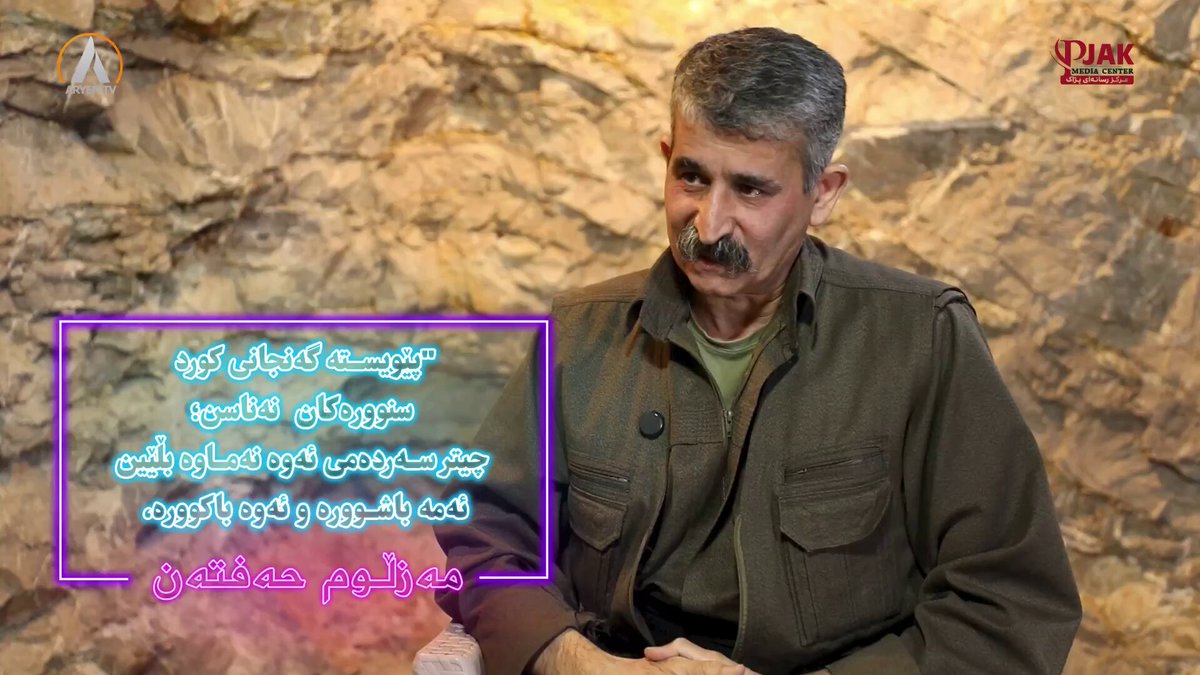TURUQIE / KURDISTAN – Quarante-sept personnes ont été condamnées à des peines de prison dans une affaire visant des avocats et des groupes de défense des droits des prisonniers et des avocats kurdes.
Le 14e tribunal pénal d’Istanbul a rendu son verdict dans une affaire visant des membres du groupe d’avocats pro-kurdes, l’Association des avocats pour la liberté (ÖHD), et l’Association de solidarité avec les familles de prisonniers (TUAD).
Après un procès qui a duré près de dix ans, 37 membres de la TUAD et 10 avocats affiliés à l’ÖHD ont été reconnus coupables aujourd’hui d’« appartenance à une organisation terroriste armée » et de « propagande terroriste ».
Les avocats ont protesté contre la décision devant le tribunal d’Istanbul à Çağlayan, en scandant des slogans kurdes tels que « Bijî berxwedana ÖHD » (Vive la résistance de l’ÖHD), « Bijî berxwedana zindana » (Vive la résistance en prison) et « La défense ne sera pas réduite en silence ».
Les accusations portées contre les membres de la TUAD étaient fondées sur leur plaidoyer contre les violations des droits dans les prisons, leurs déclarations à la presse et leurs efforts pour évaluer l’état de santé des prisonniers qui avaient entamé une grève de la faim en 2012. Pour 12 avocats de l’ÖHD, leurs activités professionnelles, notamment les visites en prison, la surveillance des tribunaux et les appels téléphoniques avec des clients et des collègues, ont été présentées comme preuve de conduite criminelle.
En attendant la décision motivée du tribunal dans les prochains jours, le droit d’appel a été maintenu.
« Légitimation du complot du réseau Gülen »
S’adressant à bianet , Emrah Baran, membre de la branche d’Istanbul de l’ÖHD, a analysé l’affaire et les implications du verdict :
« Toutes les preuves dans cette affaire ont été fabriquées par des policiers, des procureurs et des juges affiliés au mouvement Gülen. Ils ont procédé à des écoutes téléphoniques et à une surveillance illégales, ont placé des dispositifs d’écoute dans les bureaux d’associations et ont même enregistré des conversations dans les salles de rencontre entre avocats et clients dans les prisons.
Les enquêtes visant les avocats d’ÖHD ont débuté par des écoutes téléphoniques sous couvert de « détection des communications ». Ce processus a pris fin en 2013, suite au déclin de l’influence du réseau Gülen au sein du système judiciaire et de la police après les enquêtes pour corruption du 17 au 25 décembre. La collecte de preuves et les activités de surveillance ont alors été interrompues.
Les accusations reposent entièrement sur des rencontres entre avocats et leurs clients en prison, leurs appels téléphoniques, ainsi que sur une coordination et des consultations internes concernant des questions juridiques. De même, le travail de solidarité des membres de la TUAD, mené conformément aux statuts de leur association, a été qualifié d’activité criminelle dans l’acte d’accusation.
Le tribunal s’est appuyé sur des actes d’accusation et des preuves fabriqués dans le cadre d’un complot ourdi par des responsables gülenistes et a prononcé de lourdes peines de prison, notamment contre dix avocats de l’ÖHD. Cette décision légitime de fait la conspiration orchestrée par le réseau Gülen par le biais du système judiciaire. »
« Criminalisation de l’ÖHD »
« Pourtant, dans les affaires Selam-Tevhid et OdaTV, les policiers, les procureurs et les juges qui ont fabriqué des preuves similaires ont été poursuivis et condamnés.
Mais lorsqu’il s’agit d’une affaire impliquant des Kurdes et des avocats kurdes, les mêmes méthodes et preuves fabriquées n’ont pas été considérées comme faisant partie d’un complot. Au contraire, elles ont servi de base aux condamnations.
Alors que l’on entend constamment des discours sur la résolution du problème kurde, l’abandon de la violence et le renforcement de la politique démocratique, des avocats sont condamnés à des décennies de prison pour des actions qui relèvent clairement de l’engagement politique démocratique et de la défense légale.
Ceci révèle une tentative délibérée de criminaliser le travail de l’ÖHD sur les violations des droits humains et le suivi des affaires politiques. L’ÖHD réaffirme que ces condamnations ne nous arrêteront pas. Nous poursuivrons notre combat pour la justice. »
«Que notre peuple reste fort»
Par ailleurs, l’avocat Ramazan Demir figure parmi ceux qui ont reçu l’une des peines les plus sévères dans cette affaire.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux après le verdict, Demir a annoncé avoir été condamné à une peine totale de 11 ans et 3 mois de prison sans réduction, pour appartenance à une organisation terroriste et diffusion de propagande terroriste. « Que notre peuple reste fort », a-t-il écrit.
L’avocat Tamer Doğan a déclaré : « Pour avoir défendu le peuple kurde et soutenu Kobanê, le 14e tribunal correctionnel d’Istanbul nous a tous décorés de diverses médailles à l’issue d’un procès qui a duré dix ans. J’ai écopé de cinq ans et cinq mois de prison. Nous continuerons à défendre le peuple kurde et à lutter contre le génocide et les groupes djihadistes. » (Bianet)