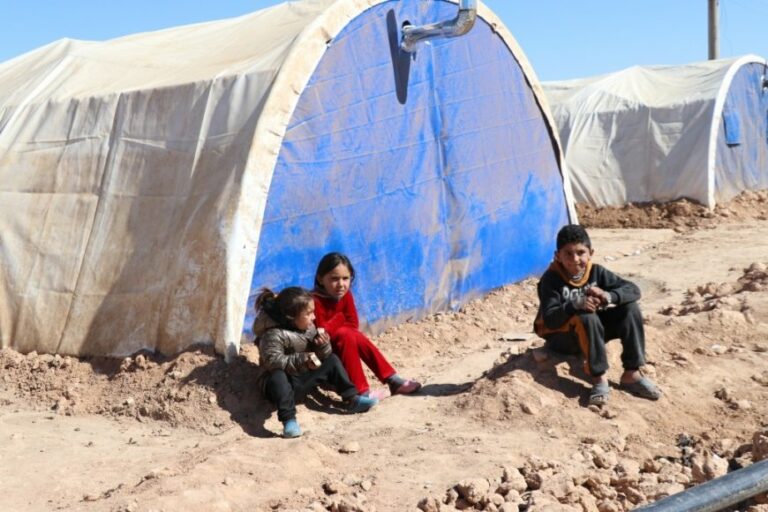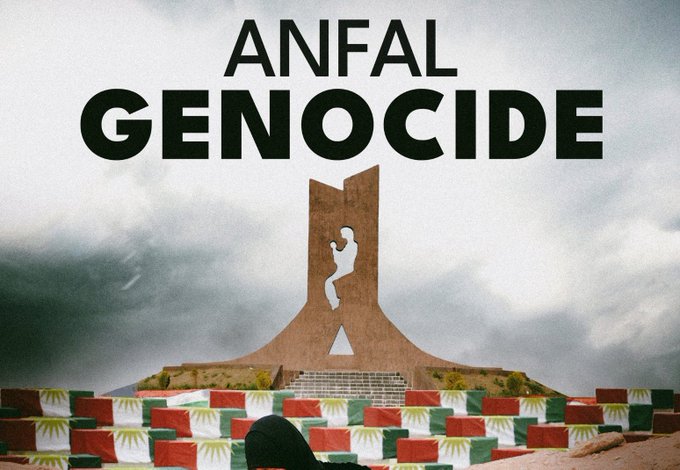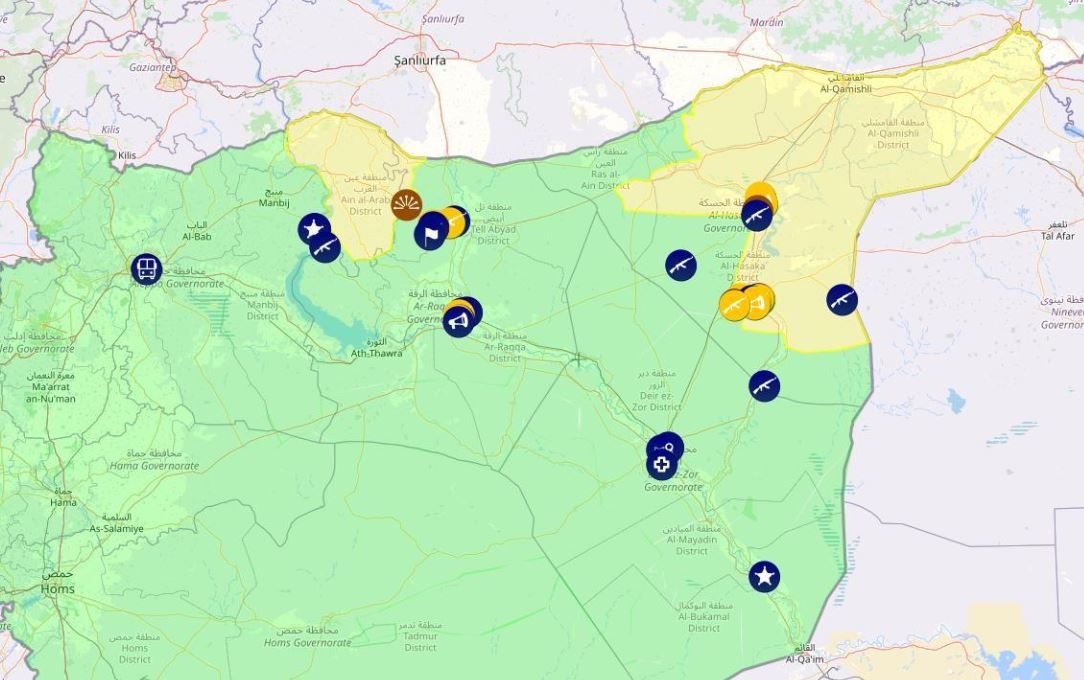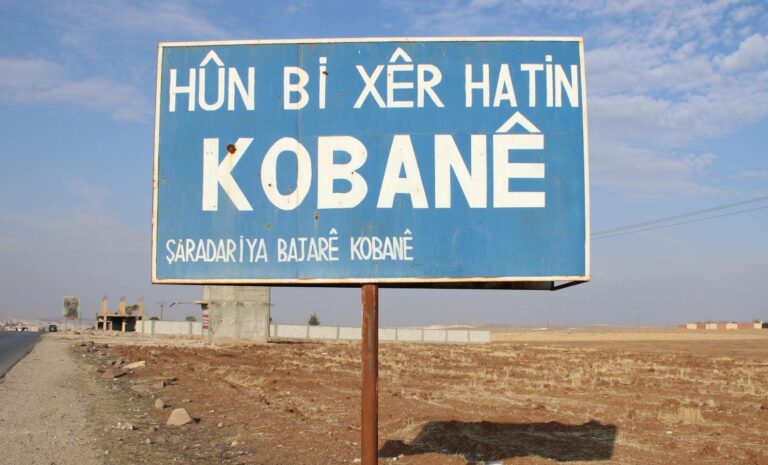TURQUIE / KURDISTAN – Haşim Oral, le frère du prisonnier politique kurde Ihsan Oral, a déclaré : « Lors de notre dernière visite, il était en proie à une forte fièvre. Après l’avoir ramené de l’hôpital, ils l’ont torturé dans sa cellule en l’aspergeant avec de l’eau froide. »

Les violations des droits humains et les actes de torture à l’encontre des prisonniers persistent dans les prisons du Kurdistan et de Turquie. Récemment, le détenu Ihsan Oral a subi des tortures physiques infligées par plusieurs gardiens dans une cellule capitonnée sans caméra de surveillance de la prison de haute sécurité de type F de Kırıkkale. Bien qu’aucun rapport d’agression n’ait été établi lors de son transfert à l’hôpital, son frère, Haşim Oral, que nous avons interrogé à ce sujet, a déclaré qu’à son retour de l’hôpital, son frère avait de nouveau été torturé, cette fois-ci déshabillé et aspergé d’eau froide dans sa cellule. Haşim Oral a indiqué que lors de leur dernière visite, Ihsan Oral était tombé malade à cause des tortures et qu’après avoir protesté auprès du directeur de la prison, son frère avait été conduit à l’hôpital pour y être soigné. Réagissant à ces événements, Haşim Oral a déclaré : « Si l’on parle de paix, cela doit aussi s’appliquer aux prisons. »
Aucun rapport d’agression n’a été établi pour torture.
L’incident s’est produit le 31 décembre 2025. Le détenu İhsan Oral s’est opposé aux transferts fréquents de cellules et à son placement dans une autre cellule. En représailles, les gardiens l’ont torturé devant l’administration pénitentiaire. Ils l’ont traîné au sol, l’ont étranglé et l’ont emmené dans une pièce capitonnée où ils ont continué à le maltraiter.
Deux autres détenus, Ahmet Herdem et Hayrullah Turan, qui avaient protesté contre la torture infligée à İhsan Oral, ont également subi des violences physiques de la part des gardiens. Après les sévices, İhsan Oral a été conduit à l’hôpital, mais aucun rapport d’agression n’a été établi. À son retour en prison, le directeur l’a de nouveau menacé : « Je vais te fracasser le crâne, je vais te crever les yeux ! Pour qui te prends-tu pour contester ces conditions et protester ? »
L’incident a conduit à la torture
Après que l’incident a été porté à la connaissance des avocats et du Parlement, Newroz Uysal, député du parti DEM Şirnex, a déposé une requête officielle auprès de la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme (IHIK) et a adressé une question parlementaire écrite et détaillée au ministère de la Justice. Suite à la révélation de l’incident, il est apparu que les prisonniers continuaient de subir les mêmes pressions et que la torture était pratiquée de manière systématique.
Après la torture de son frère, Haşim Oral a déclaré que lors de sa visite à la prison, il avait constaté que les détenus n’avaient pas accès aux soins de santé et ne trouvaient même pas de quoi se nourrir.
Torturée à nouveau après son retour de l’hôpital
Affirmant que la pression et les violations dans les prisons augmentent de jour en jour, Haşim Oral a déclaré que son frère, emprisonné depuis 2016, avait d’abord été transféré à Adana, puis à Maraş, et plus récemment à la prison de Kırıkkale, et qu’il existe un risque d’un autre transfert. Il a raconté qu’après avoir été conduit à l’hôpital suite aux actes de torture, son frère a de nouveau été torturé à son retour en prison : « Ils l’ont d’abord battu dans une pièce sans caméra, puis l’ont menacé de l’étrangler. Aucun rapport d’agression n’a été établi à l’hôpital. À son retour en prison, le directeur de la prison a de nouveau menacé mon frère de la même manière. En conséquence, à son retour de l’hôpital, il n’a pas été conduit dans son service, mais en cellule d’isolement. Là, ils l’ont déshabillé et torturé avec de l’eau froide. Après ces tortures, mon frère est retombé malade. Lors de ma dernière visite, il avait une forte fièvre. Je ne pouvais pas rester silencieux et j’ai rencontré l’administration pénitentiaire. J’ai également porté plainte pour ces actes de torture. Mon frère est en prison depuis 2016 et a été condamné à plus de 30 ans de prison. Depuis son transfert à Kırıkkale, il a subi toutes les violations de ses droits. »
Les demandes concernant l’hôpital et l’alimentation n’ont pas été satisfaites.
Haşim Oral a déclaré qu’après sa rencontre avec l’administration pénitentiaire, son frère avait reçu des soins, mais a ajouté : « Il y a tellement de problèmes dans cette prison. Il faut absolument y remédier. Les députés devraient d’abord s’y rendre. Depuis son arrivée, mon frère a perdu 15 kilos ; il n’est plus que peau et os. Ils n’ont droit à aucune activité sociale ni sportive. Lors de notre dernière visite, mon frère m’a dit : “Si ce n’est pas psychologiquement, c’est physiquement qu’ils essaient de tuer les gens.” Les demandes de transfert sont systématiquement refusées. Quand ils commandent à manger à la cantine avec leur propre argent, la nourriture arrive des semaines plus tard. Ils n’ont jamais accès à des aliments sains. Dans le quartier de mon frère, il y a aussi un détenu paralysé qui ne peut même pas aller aux toilettes seul ; mis à part les permissions de sortie, ils ne l’emmènent même pas à l’hôpital pour se faire soigner. »
Nul ne doit oublier les prisonniers
Appelant à un contrôle accru et à des améliorations face à ces violations dans les prisons, Haşim Oral a conclu : « Aujourd’hui, on parle de paix, mais si la paix existait réellement, de tels agissements ne se produiraient pas en prison. Nous exigeons une amélioration des conditions de détention. Les personnes détenues politiquement ne doivent être oubliées sous aucun prétexte. Toutes les institutions doivent se préoccuper de leur sort. Ces conditions doivent changer ; les parlementaires et le ministère doivent s’en saisir. » (ANF)