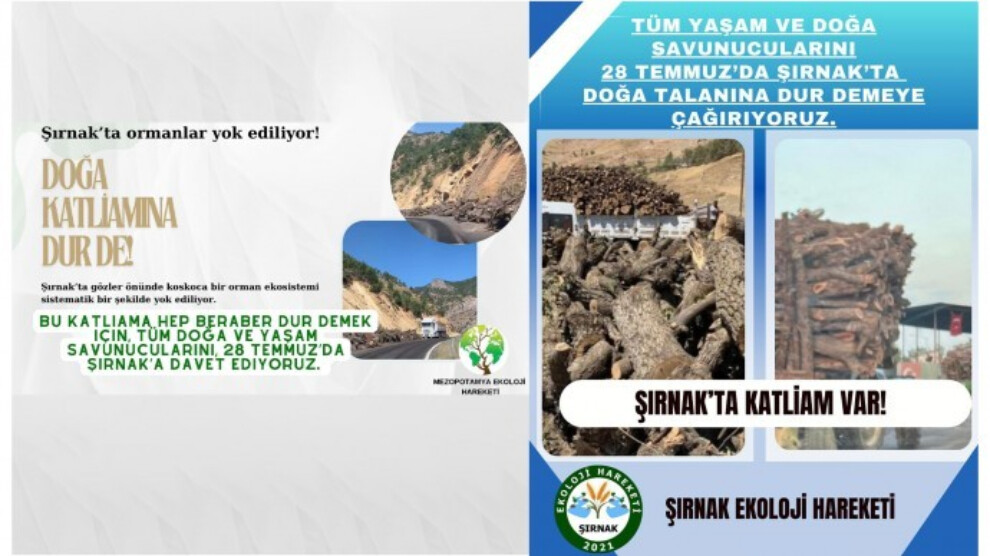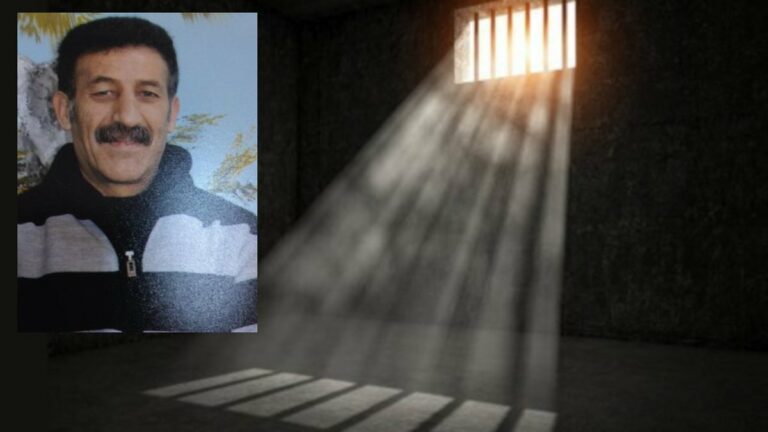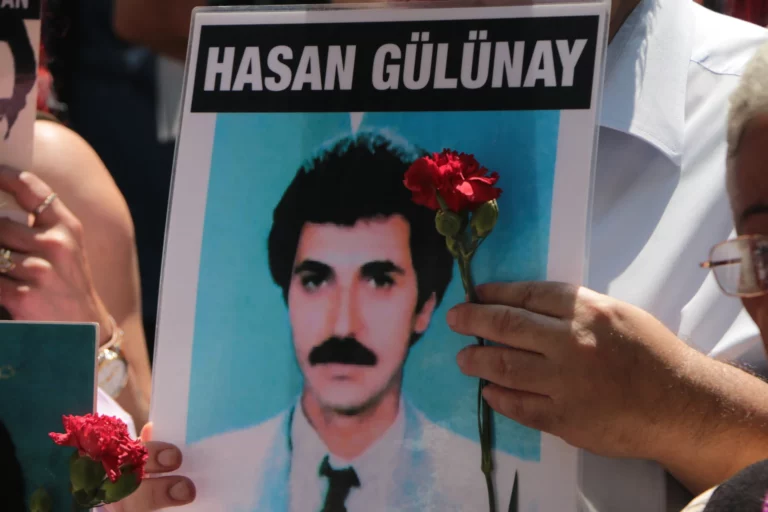SYRIE / ROJAVA – Le commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum Abdi, s’est adressé au peuple à l’occasion du douzième anniversaire de la révolution du Rojava. Il a également appeler à l’unité syrienne et aux pourparlers pour résoudre le problème syrien.
Mazloum Abdi, s’est adressé à la population de la région du nord et de l’est de la Syrie, les félicitant à l’occasion du douzième anniversaire de la révolution du 19 juillet.
Il a déclaré : « Cher peuple, je vous félicite à l’occasion du douzième anniversaire de la révolution du 19 juillet, qui a commencé à Kobané et s’est propagée dans tout le Rojava. Bien que le peuple kurde ait lancé la révolution, elle a été adoptée et soutenue par toutes les composantes du nord et de l’est de la Syrie. Nous célébrons son douzième anniversaire grâce à la résistance et au soutien de notre peuple, à l’héroïsme de nos martyrs et de nos combattants, et cela continue à ce jour. »
Le commandant en chef des FDS a rendu hommage aux premiers martyrs de la révolution en déclarant : « Je salue toutes les forces, composantes et individus qui ont participé à cette révolution depuis son début et continuent de protéger ses acquis. Dans la figure de notre grand martyr, le camarade Khabat Dêrik, je me souviens de tous nos martyrs de la révolution. À travers nos grands dirigeants martyrs comme Jinda Tal Tamir, Kendal Afrin, Ruksan, Warshin et Zakaria, et tous ceux qui ont participé au lancement de la révolution, nous nous inclinons devant eux et nous nous souvenons d’eux avec fierté et honneur. »
Concernant le rôle de la révolution dans la lutte contre les complots et les plans contre le peuple kurde et les Syriens, Abdi a expliqué : « La révolution du 19 juillet a joué un rôle majeur non seulement au Rojava et dans le nord et l’est de la Syrie, mais dans toute la Syrie. Avec le début de cette révolution, tous les plans et calculs préparés par certains partis et forces sur la Syrie ont été déjoués. Ces forces avaient préparé leurs plans pour la Syrie, mais avec le début de la révolution, ils ont été démantelés un par un. Toutes les forces qui ont marginalisé le peuple kurde et l’ont utilisé comme un outil ont échoué, et leurs plans sont partis en fumée, les poussant à changer leur politique envers le peuple kurde et la Syrie dans son ensemble. »
A propos de la participation de toutes les composantes du Nord et de l’Est de la Syrie à la révolution, il a déclaré : « Aujourd’hui, sous la direction du peuple kurde, toutes les composantes du Nord et de l’Est de la Syrie sont devenues une grande force et une grande volonté. Personne ne peut parvenir à une solution en Syrie sans eux, et tout le monde doit reconnaître cette vérité. »
En ce qui concerne les raisons de l’expansion et du rôle croissant de la révolution en Syrie et de la défaite des attaques contre elle, il a précisé : « L’expansion et le rôle croissant de la révolution du 19 juillet sont liés à sa vérité, à ses objectifs et à ses programmes, ainsi qu’aux principes sur lesquels elle a été fondée. Sur la base de cette vérité, toutes les forces qui se sont opposées et ont attaqué la révolution ont été vaincues et ont échoué, quels que soient leurs noms et leurs couleurs, comme l’Armée libre, le Front Al-Nosra, l’EI et enfin l’État d’occupation turc et ses mercenaires. Tous ceux qui se sont opposés à cette révolution ont connu l’échec. Tout comme les groupes précédents n’ont pas réussi à combattre la révolution, le sort de l’occupation turque et de tous ses mercenaires sera le même, les obligeant à changer leur politique envers notre peuple et toutes les composantes du nord et de l’est de la Syrie. »
Concernant les objectifs fixés par la révolution dès le premier jour et les objectifs des autres forces, le commandant en chef des FDS a déclaré : « La révolution du 19 juillet a été lancée pour protéger le peuple et ses acquis. Alors que toutes les forces et tous les partis en Syrie se battaient et s’entretuaient pour des raisons sectaires, ethniques et religieuses, commettant des massacres allant jusqu’à la décapitation, les villes du Rojava ont été libérées sans effusion de sang. Nous n’avons exercé que notre droit à l’autodéfense contre les forces qui nous ont attaqués. Au sein des Forces démocratiques syriennes et auparavant au sein des Unités de protection du peuple et des Unités de protection des femmes, nous n’avons jamais lancé d’attaque contre aucune force en Syrie ; nous avons seulement protégé les acquis de notre révolution et de notre peuple. Aujourd’hui, nous poursuivons cette mission et ce travail. Si personne ne nous combat, nous ne le combattrons pas. Cependant, si une force nous attaque, nous nous défendrons comme nous l’avons fait par le passé, mais encore plus fort. »
Concernant la solution de la crise syrienne et le dialogue entre les Syriens, le commandant en chef des FDS a souligné : « Aujourd’hui, tout le monde sait que la crise syrienne ne peut être résolue par la violence, la guerre et les combats. Tout le monde doit voir cette vérité, et la crise ne peut être résolue sans dialogue. Nous sommes prêts au dialogue avec toutes les parties, même avec les forces actives sur le terrain dans la crise, juste pour parvenir à une solution qui mette fin à la crise. » Il a souligné : « En même temps, nous, les Forces démocratiques syriennes et les composantes du nord et de l’est de la Syrie, avons nos principes et nos droits fondamentaux qui doivent être pris en compte, et nous devons aller ensemble au dialogue pour parvenir à une solution radicale à la crise.
Nous sommes prêts à dialoguer avec toutes les forces, y compris la Turquie, et nous soutiendrons tout dialogue qui mènera à la cessation des combats et à une solution politique à la crise », a-t-il ajouté. « Nous avons toujours œuvré pour l’unité de la géographie syrienne et pour empêcher sa division, et nous poursuivrons cette lutte et ce travail aujourd’hui et demain. Notre politique d’aujourd’hui préserve l’unité du territoire syrien. »
Commentant le rôle des forces régionales et internationales et du régime syrien dans les régions du nord et de l’est de la Syrie, le commandant en chef des FDS a déclaré : « Aucune mesure ne doit être prise au détriment de notre peuple et des composantes du nord et de l’est de la Syrie. Nous souffrons beaucoup dans nos régions en raison de l’opposition des forces régionales et internationales et de l’intervention flagrante et négative du régime syrien, qui affecte les conditions économiques et sociales dans nos régions, une vérité dont nous sommes bien conscients.
Cependant, tout comme nous avons résisté et résisté à toutes les attaques, en particulier contre l’EI et les attaques de l’État turc, nous serons désormais en mesure, en nous appuyant sur notre force, de surmonter également ces difficultés. »
Concernant l’unité interne, il a déclaré : « À l’occasion du douzième anniversaire de la révolution, notre premier objectif est de renforcer notre front intérieur. Nous devons renforcer l’unité nationale entre toutes les composantes de la région, y compris les Kurdes, les Arabes, les Syriaques, les Arméniens et les autres, plus que jamais. Comme nous avons été unis dans la défense de nos régions et de nos acquis, où la jeunesse de toutes les composantes a sacrifié son sang pour protéger nos régions, nous sommes obligés de maintenir notre unité interne plus que jamais pour protéger nos acquis obtenus avec le sang de nos martyrs et surmonter ces difficultés. »
Concernant les Forces démocratiques syriennes, il a déclaré : « Pour dissuader toutes les forces et attaques extérieures sur nos régions, nous allons certainement œuvrer pour renforcer les Forces démocratiques syriennes plus que jamais. Au cours des quatre dernières années, nous avons mené une lutte intense et étendue. Lors du lancement de la révolution du 19 juillet, nos effectifs se chiffraient à plusieurs centaines, et aujourd’hui nos forces armées dépassent les cent mille combattants. Nous avons mis en place de fortes forces spéciales et développé nos forces en termes de possession et d’utilisation des dernières technologies militaires, en établissant des fronts et des fortifications, et en développant nos forces militaires horizontalement et verticalement. »
Concernant la capacité des forces des FDS à repousser les attaques sur leurs zones, il a déclaré : « Je le dis franchement pour que tout le monde se sente à l’aise et rassuré ; nos forces sont suffisantes et prêtes à repousser toutes sortes d’attaques sur nos zones. L’un de nos objectifs pour la treizième année de la révolution, c’est-à-dire cette année, est d’élargir davantage nos forces pour atteindre un niveau profond de professionnalisme dans les arts du combat et de la guerre pour défendre nos zones et surmonter les problèmes administratifs et sociétaux dont souffre notre peuple. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions et surmonter ces problèmes. »
En conclusion, Mazloum Abdi a félicité une fois de plus le peuple à l’occasion du douzième anniversaire de la Révolution du 19 juillet, en déclarant : « Si nous abordons ces problèmes dans l’esprit de la Révolution du 19 juillet, nous obtiendrons de grands succès. Tout comme nous avons réussi à protéger nos acquis et nos réalisations au cours des douze dernières années de la révolution, nous obtiendrons sans aucun doute de plus grands résultats au cours de sa treizième année. Une fois de plus, je vous félicite à l’occasion de l’anniversaire de la révolution et vous souhaite du succès et de la victoire dans votre travail et votre lutte. »