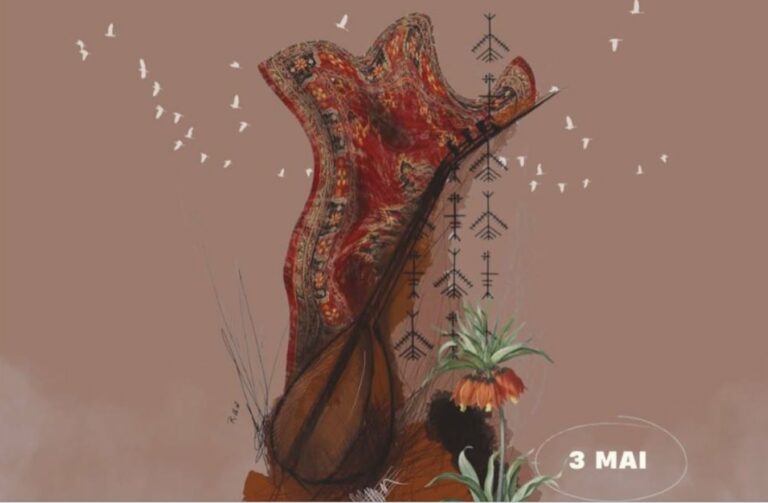TURQUIE / KURDISTAN – La députée du DEM Parti, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit a déclaré que le peuple kurde ne pouvait pas perdre un autre siècle et a déclaré que la conférence de Rojava influencera tout le Kurdistan.
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, députée de Van (Wan) du Parti de l’égalité des peuples et de la démocratie (DEM), qui s’est rendue au Rojava pour la Conférence sur l’unité et la position commune des Kurdes du Rojava qui s’est tenue à Qamishlo le 26 avril dernier, a répondu aux questions de l’ANF concernant les résultats de la conférence et ses impressions du Rojava.
Quelles sont vos impressions sur le modèle de gouvernance mis en œuvre dans le nord et l’est de la Syrie ?
Même si c’était notre première visite dans le nord et l’est de la Syrie, nous connaissions déjà le modèle local. C’est d’ailleurs un modèle que nous avons suivi au Kurdistan du Nord (Bakur) et en Turquie. Comme vous le savez, c’est un lieu où cohabitent des peuples très différents, tant sur le plan religieux, ethnique et culturel que linguistique. Le modèle local considère cette diversité comme une richesse et s’efforce de la faire vivre. C’est un véritable exemple à suivre pour le monde entier. Je peux dire que c’est un modèle remarquable et très important où chacun peut vivre ensemble, dans le respect des sensibilités de chacun.
Avec quels objectifs avez-vous participé à la Conférence sur l’unité et la position commune des Kurdes du Rojava en tant que délégation turque ?
M. Abdullah Öcalan est détenu à l’isolement en Turquie depuis près de 27 ans, et cette politique d’isolement perdure encore aujourd’hui. Depuis quatre ans, il est soumis à ce que nous appelons une détention au secret absolu. Comme vous le savez et l’avez suivi de près, un nouveau processus a débuté avec la poignée de main de Devlet Bahçeli avec le groupe du Parti DEM le 1er octobre. Peu après, Ömer Öcalan a rendu visite à Abdullah Öcalan à la prison d’Imralı. M. Öcalan a alors réitéré ce qu’il avait déjà déclaré en 1993 : « Je crois que la question kurde doit être résolue par des moyens démocratiques et pacifiques, et j’y suis prêt. » Par la suite, une délégation, composée notamment de Pervin Buldan et de Sırrı Süreyya Önder, qui faisaient également partie de la précédente délégation d’Imralı, a de nouveau rencontré M. Öcalan.
Lors de cette réunion, M. Öcalan a exprimé les points de vue suivants : « Je suis prêt, mais chaque parti doit assumer ses responsabilités. » Il a confié une grande partie du travail à la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM), proposant la création d’une commission composée de représentants de tous les partis pour mener à bien le travail juridique et politique nécessaire. Il a transmis ses suggestions et messages en conséquence. Lors de cette réunion, M. Öcalan a également exprimé son souhait de connaître l’avis des acteurs de chaque région du Kurdistan sur ce processus, leurs réflexions et leurs propositions. Comme vous le savez, nous avons déjà effectué une visite au Kurdistan du Sud (Başûr) dans le cadre de cette visite, mais nous n’avions malheureusement pas pu nous rendre au Kurdistan oriental (Rojhilat) et au Rojava (Kurdistan occidental) à cette époque.
Aujourd’hui, dans le cadre de l’appel lancé le 27 février par M. Öcalan, que nous qualifions d’historique et intitulé « Paix et société démocratique », nous avons tenu des réunions non seulement au Kurdistan du Nord, mais aussi dans toute la Turquie. Nous avons tenu de nombreuses réunions avec des organisations de la société civile, des partis politiques, des organisations de femmes et notre peuple. Nous avons organisé ces réunions dans plus de 100 centres, travaillant avec notre peuple pour élaborer une feuille de route définissant les implications de cet appel à la paix et à la société démocratique, ses modalités de mise en œuvre et les actions à entreprendre. Dans ce cadre, notre délégation s’est à nouveau rendue au Kurdistan du Sud et a mené deux séries de réunions.
C’est dans ce même contexte que nous nous trouvons aujourd’hui, et le fait que la conférence du Rojava s’inscrive dans ce processus a été pour nous une heureuse coïncidence. Assister à une conférence aussi importante, consacrée aux efforts d’unité, à la construction d’une société démocratique et à la résolution pacifique de la question kurde, et être présent à un moment aussi historique, a été pour nous extrêmement significatif. Je peux l’affirmer avec assurance au nom de notre délégation du Kurdistan du Nord et de notre parti.
Comment les résultats de la conférence pourraient-ils influencer les discussions sur la question kurde en Turquie ? Quel message comptez-vous transmettre à l’opinion publique et aux acteurs politiques turcs à l’issue de cette conférence ?
Je peux affirmer que cette conférence est véritablement historique. Comme vous le savez, le Rojava est une région engagée depuis longtemps dans des luttes. Il est extrêmement précieux pour nous qu’une telle avancée ait émergé de cette lutte. La conférence d’aujourd’hui marque le début d’un processus qui restera gravé dans l’histoire. Les développements qui en découleront, notamment la reconnaissance de l’identité et du statut kurdes en Syrie, auront sans aucun doute un impact sur les autres régions du Kurdistan. Chaque action, initiative et réglementation juridique qui sera élaborée en vue de cette reconnaissance influencera l’ensemble de la région. Par exemple, la reprise potentielle des rencontres avec M. Öcalan et son insistance à résoudre ce problème par des moyens démocratiques, ainsi que son appel à une société démocratique, puisent leur force dans ce contexte.
Si nous sommes aujourd’hui au Rojava, c’est précisément grâce à cet élan. C’est grâce à cette force que nous pouvons organiser ces réunions et assister à une conférence aussi historique. Toute avancée dans l’une des parties aura inévitablement un impact positif sur les autres. Comme nous l’avons déjà dit, le peuple kurde ne peut se permettre de perdre un siècle de plus. Comme vous le savez, depuis un siècle, nous vivons divisés par des frontières physiques tracées entre les quatre parties du Kurdistan. Pourtant, malgré ces frontières physiques, le peuple kurde n’a jamais intériorisé ces divisions, ni mentalement ni spirituellement. Nous sommes convaincus que dans les années à venir, cet esprit d’unité nationale émergera encore plus clairement, surmontant ces divisions artificielles, tant dans l’esprit que dans la pensée, et ouvrant la voie à une action collective plus forte.
Cette conférence pourrait-elle conduire à un changement dans la politique turque à l’égard du Rojava ? Comment pourrait-elle contribuer à la résolution de la question kurde en Turquie ?
Je crois que la Turquie doit désormais se défaire de ses préjugés à l’égard de l’administration du nord et de l’est de la Syrie. Si nous parlons aujourd’hui de paix avec les Kurdes en Turquie, nous devons également rechercher la paix avec les Kurdes partout dans le monde. De fait, ces efforts doivent être menés conjointement avec les Kurdes de toutes les régions et dans le respect de leurs acquis. Tenter de faire la paix avec les Kurdes à l’intérieur de ses frontières tout en maintenant l’hostilité envers les Kurdes au-delà de ces frontières ne profitera ni à la Turquie ni aux autres parties du Kurdistan. Par conséquent, la Turquie doit véritablement mettre fin à ses préjugés à l’égard de l’administration autonome de cette région. Elle doit également promouvoir une attitude positive envers les droits du peuple kurde et de toutes les autres communautés vivant ensemble dans cette région.
Que pensez-vous des organisations de femmes du Rojava ? En quoi constituent-elles un modèle pour d’autres mouvements de femmes au Moyen-Orient ?
Permettez-moi d’être très clair : tout d’abord, je dois dire que j’admire profondément l’organisation de femmes ici. Tout ce qui est fait est mené par des femmes et est concrétisé par leur initiative. Ce modèle est véritablement ambitieux. Il peut servir d’exemple au monde entier. Il existe actuellement ici un modèle de vie qui suscite la curiosité, l’inspiration et l’observation attentive du monde entier, un modèle né sous l’impulsion des femmes. Même si c’est notre première visite depuis le Kurdistan du Nord, nous pouvons déjà entendre et constater cette réalité. Cela devient encore plus clair au fil des conversations : des amis ici mentionnent que des délégations de nombreux pays viennent constamment témoigner de la construction de ce nouveau modèle de vie. Elles veulent le voir et l’expérimenter par elles-mêmes. Franchement, cela apparaît également comme une réalité passionnante et inspirante pour nous, Kurdes du Kurdistan du Nord. Ce modèle de vivre ensemble, ce modèle de coexistence, nous est précieux. Nous pensons qu’un tel modèle démocratique, qui défie la mentalité de l’État-nation en mettant l’accent sur la coexistence, doit émerger partout.
Nous puisons notre force dans l’organisation bâtie sous le leadership des femmes. Même lorsqu’elles s’expriment ici, elles le font avec une telle assurance que l’on ressent le succès, le combat et les victoires remportés grâce à ce combat. Les réalisations des femmes ici présentes servent aujourd’hui d’exemple au monde entier. Parallèlement, la fierté et l’honneur de mener un tel processus se reflètent dans chaque aspect de leur travail.
Comment la Conférence nationale kurde du Rojava pourrait-elle contribuer à la reconnaissance régionale et internationale du modèle d’administration autonome ?
Ce modèle de gouvernance est observé de près par beaucoup. Il peut servir d’exemple à tous ceux qui aspirent à une vie démocratique. Cependant, il constitue également un modèle incompatible avec le système capitaliste et la mentalité de l’État-nation, car il représente une troisième voie. Cette troisième voie est cruciale pour ceux qui aspirent à une vie démocratique, et ce modèle est reconnu, évalué et débattu dans de nombreuses régions du monde lors de panels, de conférences et de colloques.
La conférence qui se tient aujourd’hui au Rojava n’est pas seulement une étape importante pour le Rojava ou les autres peuples qui y vivent actuellement ; c’est une étape importante pour toutes les régions du Kurdistan. Dans un premier temps, elle sera peut-être particulièrement significative pour les habitants du Rojava, mais elle aura également un impact sur les quatre régions du Kurdistan et sur l’ensemble du Moyen-Orient. Avec cette conférence, les graines de cet impact plus large ont été semées ici. Une étape importante se profile : après la conférence, des réunions auront lieu avec Damas sur des sujets tant juridiques que politiques. Une fois le travail officialisé lors de la conférence consolidé, les puissances internationales seront contraintes de reconnaître cette administration.
Enfin, avez-vous un message du Rojava à adresser aux milieux politiques et à la population ?
Au Kurdistan du Nord, nous avons toujours suivi de loin la lutte au Rojava. Pourtant, nous l’avons toujours admirée. Être ici aujourd’hui, sur ces terres, la voir, la ressentir, la toucher et dialoguer avec les gens est vraiment précieux pour nous. Comme vous le savez, à quelques centaines de mètres de chez nous se trouve Nusaybin. À Nusaybin, de nombreux frères, sœurs, cousins et proches de ceux qui sont ici vivent, mais la frontière étant fermée, ils ne peuvent ni communiquer ni se rendre visite. Nous sommes nous-mêmes arrivés ici par Erbil (Hewlêr), même si le trajet par Nusaybin aurait été beaucoup plus court. Ces portes doivent être ouvertes. L’État turc doit prendre les mesures nécessaires à cet égard. Empêcher les contacts n’arrêtera pas la lutte du peuple kurde ; les Kurdes continueront de se battre par tous les moyens.
Désormais, ils poursuivront ce combat avec encore plus d’énergie, dans un esprit d’unité. C’est pourquoi ces frontières, ces portes, doivent être supprimées. Les problèmes liés à la fermeture de ces frontières ne profitent pas non plus à la Turquie. Cela doit être clairement exprimé. Si la Turquie souhaite véritablement parvenir à la paix avec les Kurdes à l’intérieur de ses frontières, elle doit également reconnaître et faire la paix avec les Kurdes des autres régions. Croyez-moi, ce faisant, la Turquie en bénéficiera, tous les peuples de Turquie en bénéficieront, et surtout le peuple kurde. Je suis très heureuse d’être ici. Je suis fière d’assister à cette conférence historique. Je suis également très heureuse que nous puissions transférer l’expérience acquise ici au Kurdistan du Nord et en Turquie. (ANF)