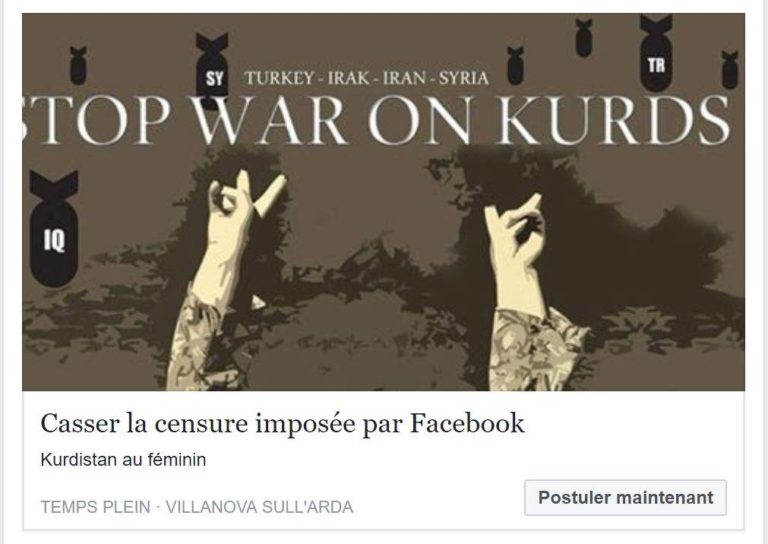Le mouvement des femmes kurdes est récemment devenu un sujet d’intérêt, de recherche et de fascination. Zîlan Diyar a été témoin et a participé au développement de la révolution radicale des femmes au Kurdistan pendant près de trois décennies et partage l’analyse de l’histoire du mouvement.
A une époque de luttes historiques de résistance d’Afrin et dans les quatre parties du Kurdistan, avec des sacrifices aussi immenses au nom de la liberté, il est difficile de trouver les mots pour décrire notre histoire de lutte sans commémorer tous ceux qui ont perdu la vie sur le chemin. Cela me fait penser aux paroles de Kezban Mavi (Leyla), une combattante turque de Kayseri, qui a perdu la vie dans nos montagnes Zagros en 1999 :
« En vérité, la guerre au Kurdistan est un roman qui n’a pas été écrit et qui ne peut être écrit. Elle ne peut être que vécue. Mais, néanmoins, comment pouvons-nous inscrire cet héritage dans l’histoire ? »
Nous sommes actuellement à la recherche d’une réponse à la question de Leyla. Sans aucun doute, chaque femme kurde a une réponse à sa question. Cependant, j’essaierai de me référer à notre mémoire collective et sociale pour tenter de décrire notre histoire.
L’histoire de notre lutte peut être retracée du village de Fis à Amed (Diyarbakir) à Raqqa en Syrie, un long chemin pavé de sacrifices et de difficultés incroyables. Nous avons payé un prix élevé en marchant sur ce chemin ; nous avons mené des résistances historiques, créé des beautés et assisté à des souffrances insupportables que nous n’avons pas encore pleinement affrontées. Les femmes ont toujours été dans le « levain » de notre lutte pour la liberté, avant même Fis, le village où le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) s’est formé dans une maison en terre battue. Dès le début, depuis que le groupe qui formera plus tard le PKK s’est réuni, les femmes ont été parmi les personnes attirées et curieuses par la révolution. Cependant, on peut dire que la libération nationale et la lutte des classes étaient leurs principales motivations à l’époque. Pas la liberté, mais l’égalité étaient les priorités. Bien sûr, cette notion d’égalité est déterminée par les structures et les mentalités patriarcales. Pour cette raison, l’existence des femmes et les succès de la révolution ont été déterminés par les normes et les mesures des hommes. Soulever des objets lourds comme des hommes, se battre comme des hommes, marcher comme des hommes. Ce que j’essaie de dire, c’est que nous avons connu les mêmes obstacles et les mêmes lacunes que toutes les autres luttes inspirées par la théorie marxiste. (…)
Après le tir de la première balle de la guérilla du PKK, le début de la lutte armée le 15 août 1984, nous avons assisté à une augmentation quantitative de la participation des femmes aux soulèvements populaires (serhildan en kurde) au Kurdistan rural au début des années 90. Plus que les raisons, nous devons considérer les résultats de cet afflux de femmes dans la lutte. Dans une sphère de privilège masculin, la femme disait « Moi aussi, j’existe ». Les femmes du Kurdistan rejettent donc leur statut social. La femme, qui était constamment mise en réserve par les hommes, essayait de s’affirmer. Cela se heurte à la résistance et aux réactions de rejet, car l’homme kurde se contentait de sa position privilégiée dans la société. Par conséquent, la quête de liberté des femmes n’a souvent pas transgressé les cadres du patriarcat et s’est limitée à exiger des droits. De plus, en raison de l’influence de la religion, du colonialisme et des formes les plus corrompues du capitalisme au Kurdistan, la société n’était pas prête. Il y avait cependant des femmes qui tentaient de briser ces cadres et ces tabous. Il y avait des femmes qui résistaient, interrogeaient, fouillaient et créaient. Sakine Cansiz (nom-de-guerre Sara), l’une des cofondatrices du PKK, qui a dirigé la résistance historique à la prison de Diyarbakir au début des années 1980 et qui a fondamentalement façonné le caractère libéré des femmes du PKK et qui a été assassinée avec Fidan Dogan et Leyla Saylemez, à Paris le 9 janvier 20013 ou Zeynep Erdem (nom-de-guerre Jiyan), qui a mené les luttes populaires dans le camp de réfugiés de Mexmûr, mais a été assassiné par les forces de sécurité du Parti démocratique du Kurdistan (KDP) en 1995, ne sont que deux exemples parmi tant d’autres. Cependant, faute d’une lutte suffisamment organisée à l’époque, beaucoup de ces efforts ont rapidement échoué. Sans organisation, il n’est pas possible de refléter les niveaux de liberté qui émergent dans les personnages des individus sur l’ensemble de la société.
C’est là que notre chef Apo a vu le pouvoir transformateur du travail des femmes. Prenant la libération des femmes comme point de départ, il commence à développer des approches pour résoudre des problèmes de société. Pour les conditions de l’époque, il a développé des analyses très progressives. Son livre « La femme et le problème de la famille au Kurdistan » a été publié pour la première fois en 1987 et traite de ces questions.
C’est ce qui ressort de l’analyse faite le 8 mars, Journée internationale des femmes :
« On affirme que dans la mesure où la révolution permettra la transformation de la société, la transformation des femmes aura lieu. On a toujours écrit et analysé de cette façon. Cependant, comme on s’attend à ce que cela se produise spontanément, cela ne donne pas les résultats escomptés. En ce sens, il n’est pas possible de prétendre que « dans le socialisme, celui qui travaille le plus gagne le plus et celui qui pense le plus, travaille le plus » et de se dégager ainsi de ses obligations. »
A partir de ce moment, les analyses centrées sur les femmes se sont développées davantage. Il s’agissait d’une intervention pour transformer les mentalités dominantes. Dans le même temps, des progrès ont été réalisés pour cultiver de nouvelles mentalités sous la forme de nouvelles formes d’organisation. La théorie et la pratique se sont donc toujours développées main dans la main dans notre mouvement. Parfois, des mesures pratiques nous ont permis d’élaborer de nouveaux aspects de la théorie. Parfois, nos conclusions théoriques ont changé les modes et les contenus de notre organisation. Avec une organisation accrue, notre lutte idéologique s’est développée. Avec notre première structure féminine, l’Union des femmes patriotiques du Kurdistan (YJWK) en 1987, une prise de conscience a émergé qui a encouragé et renforcé la lutte idéologique des femmes. C’est à partir de ce point de départ que la décision a été prise d’organiser des unités autonomes dans le domaine de l’autodéfense. Cette décision, prise à la fin de 1993, a conduit les femmes à affirmer leur présence dans tous les domaines où elles avaient été poussées en arrière : dans la guerre, dans le leadership idéologique, dans l’administration et l’éducation. Ces étapes ont illustré le potentiel et le pouvoir des femmes. L’Union pour la liberté des femmes du Kurdistan (YAJK), créée en 1995, représente la participation des femmes dans tous les domaines avec leur identité autonome. Elle est apparue comme un besoin, mais en même temps, elle a constitué une évolution vers l’objectif de la liberté des femmes. L’émergence de YAJK a également jeté les bases de notre « idéologie de la libération des femmes » et de la « partîbuyin » (« devenir parti »). A partir de cette période, de fortes analyses se sont développées dans le mouvement. En conséquence, les questions de classe et de genre ont été traitées de manière plus productive. Plutôt que de fuir ces questions ou de les retarder comme d’autres contextes, nous les avons affrontées. Nous avons mis au point une méthode pour examiner les événements et les phénomènes chez les individus afin d’examiner la société. Le leader Apo appelait cela « analyser non pas l’individu, mais la société ; non pas le moment mais l’histoire ». Parallèlement, pour élargir la portée de cette conscience qui, au début, ne pénétrait pas l’ensemble de notre socialité, des efforts et des luttes individuelles ont été soulignés pour nous aider à donner un sens aux philosophies de vie et à les rendre significatives. Dans le même temps, de nouvelles mesures ont été prises pour permettre aux femmes de sortir des sphères où le patriarcat était institutionnalisé.
C’est pourquoi il est si fondamental de comprendre l’affirmation audacieuse selon laquelle la libération des femmes est plus précieuse que la liberté d’un pays. Au fur et à mesure que nous avancions vers la formation de notre propre parti de femmes autonomes, cela est devenu évident. Chaque théorie et chaque modèle de libération des femmes au Kurdistan a trouvé sa réponse adaptée à son époque. Des luttes sans égal ont été menées pour ne pas abandonner sa volonté à l’ennemi ou à la domination masculine.
C’est vraiment la femme qui a permis au concept de liberté de prendre tout son sens. Et c’est alors qu’il est devenu évident qu’une société dans laquelle les femmes ne sont pas libres, ne peut l’être non plus. La norme de la liberté est fixée par la situation des plus opprimés.
« Si nous voulons donner une validité et un sens à des termes tels que égalité, liberté, démocratie et socialisme qui ne conduisent pas à la déception, il est important de rompre avec les anciens liens relationnels ».
Comment ces vieux liens sociaux peuvent-ils être détruits ? En rompant avec des habitudes mémorisées, intériorisées, en lisant les choses à l’envers. Par exemple, l’habitude d’une division claire du travail. Soudain, les femmes épaulaient leurs camarades masculins blessés. Autrefois, les mères apprenaient à leurs filles à faire du crochet et de la broderie, mais aujourd’hui, les jeunes femmes apprennent à leurs mères à utiliser des armes pour se défendre. Alors que la bravoure était un concept masculin dans la société kurde, elle s’applique de plus en plus aux femmes. Il devient de plus en plus évident que des termes tels que l’honneur et la beauté, qui ont été déterminés par des pratiques patriarcales donnant un sens, sont en fait liés à la mesure dans laquelle nous parvenons à créer une société politico-éthique.
Notre prétention à résoudre la principale contradiction de l’histoire n’a fait que croître depuis la fondation de YAJK.
En 1996, dans une interview à un journaliste, Öcalan a inventé l’expression « tuer l’homme », qui s’est ensuite prêtée aux discussions théoriques. Cela a lancé les discussions sur le « meurtre de l’homme » à partir de 1996, mais il n’a pas été facile de convaincre et d’attirer les hommes kurdes dans ces discussions.
« Nos hommes ne s’approchent pas avec l’intention de s’auto-analyser. Puisque les hommes ne semblent pas ressentir ce besoin, les femmes doivent développer des attributs de déesse. Qu’entend-on par là ? La femme doit devenir volonté-puissance, conscience, en fait, une force de création et de construction. A moins que des femmes comme celle-ci n’émergent, il sera difficile d’attendre de nos hommes qu’ils se ressaisissent » (Abdullah Öcalan).
Plus tard, ces discussions ont pris un caractère plus concret. Entre 2002 et 2004, les formations éducatives pour les hommes dans les académies féminines ont été très importantes. Les hommes ont appris à connaître les connaissances des femmes, leurs méthodes et leurs moyens de résoudre les problèmes sociaux. Les résultats de ces formations ont été publiés sous forme de livres. Nous n’avons plus cette éducation, parce que cet engagement critique envers la patriarcat est maintenant répandu dans toutes nos académies.
Pour une nouvelle vie, il est nécessaire que les hommes remettent en question leur relation avec eux-mêmes, à la femme, à tous les autres secteurs de la société et à la nature. L’achèvement du processus de transformation des sociétés qui a commencé avec les femmes sera possible avec la transformation des hommes. Notre réalité historique nous a démontré de manière douloureuse qu’avec l’identité dominante et la compréhension de la masculinité, qui ne suffit pas pour une vie libre et égale et qui est donc incapable de construire une relation juste d’amour et de respect avec les femmes, nos devoirs envers l’humanité ne peuvent être remplis.
La « théorie de la séparation », le « divorce total » et plus tard l' »idéologie de la libération des femmes » étaient tous nos efforts théoriques pour surmonter les aspects habituels de notre monde mental. Ces considérations théoriques ont en même temps conduit à l’étape pratique de la formation de notre parti des femmes, le PAJK d’aujourd’hui. Il s’agissait pour nous d’un jalon important, car il constituait le besoin le plus urgent d’entrer dans le XXIe siècle avec une lutte idéologique anti-système à un niveau supérieur, une lutte qui a également le pouvoir de proposer de nouveaux systèmes alternatifs et autonomes. Il était important de renouveler notre forme, d’approfondir notre idéologie, de concrétiser notre lutte pratique. Après les époques de la classe et des nations, nous étions prêtes à lancer une ère de révolutions féminines. Avec la formation du parti, la lutte des femmes au Kurdistan a obtenu une qualité plus universelle. L’idéologie de la libération des femmes et la formation des partis sont étroitement liées l’une à l’autre. L’idéologie de libération des femmes doit être universelle. Elle ne peut être une idéologie que si elle s’appuie sur ses racines et établit un lien avec l’univers.
Il est vrai que tous les progrès réalisés jusqu’à la formation du parti des femmes ont rompu avec les formes de relations dominantes entre les femmes et les hommes dans la société. Mais ce n’était pas suffisant. Il est vital de tisser à nouveau ces liens brisés d’une manière différente. Notre concept de « co-vie libre » constitue une réponse à ce besoin. Si nous devions l’expliquer, cela signifierait recréer des relations entre les femmes et les hommes débarrassés des notions de propriété. Redéfinir les notions de reproduction et d’amour pour ne pas comprendre la reproduction comme procréation, mais dans le sens d’ajouter un sens à la vie de diverses manières, afin de comprendre l’amour comme la concentration de son énergie en un seul endroit pour un but. Pour ce faire, nous devons définir des normes pour les femmes et les hommes libérés.
Grâce à nos efforts, on n’associe plus la rencontre immédiate des femmes et des hommes à la domination ou à la sexualité. De telles rencontres impliquent désormais des créations politiques, économiques et culturelles. Alors que notre notion de co-vie libre en définit les dimensions philosophiques, notre système confédéral, y compris le principe de co-présidence que nous appliquons dans toutes les sphères de notre système, constitue les aspects concrets de ces nouvelles façons de se relier les uns aux autres.
Il y a une seule raison pour laquelle notre lutte est devenue si vaste et si populaire : c’est parce que nous n’avons pas retardé la liberté des femmes à un moment après la révolution, mais que nous l’avons transformée en une cellule souche de notre révolution. Par exemple, les femmes sont le fondement de notre notion de « nation démocratique », qui prévoit la coexistence pacifique et solidaire entre différentes cultures, ethnies, groupes confessionnels et groupes sociaux. C’est parce que notre priorité est de libérer la femme comme la plus opprimée parmi les opprimés. Pour la « modernité démocratique » que nous voulons faire revivre contre l’ère de la modernité capitaliste, pour refluer et refleurir (Öcalan les décrit comme deux fleuves), il est crucial de rendre visible la résistance des femmes dans l’histoire et dans le présent. Réaliser l’existence de tant de luttes individuelles et collectives de femmes à travers le monde alors que nous essayions de rendre notre propre lutte visible et puissante ne nous a pas seulement encouragées. Elle a révélé en même temps les piliers de la « modernité démocratique ». Bien que nous ayons commencé à partir de nos propres besoins, nous avons contribué à rendre visible la lutte des femmes dans le monde. La notion de « sociologie de la liberté » d’Öcalan est un autre concept important pour nous en tant que femmes. A une époque où le capitalisme attribue à la femme une identité marquée par la crise, nous nous efforçons constamment de résoudre ces crises en faveur de potentialités de liberté. Chaque jour, nos femmes disent non à la violence domestique et vont dans nos centres communautaires, elles refusent les mariages forcés et se joignent à la lutte de la montagne [lutte armée] contre le système, elles font confiance à leurs camarades femmes pour leurs expériences de viol et de violence sexuelle, elles décident d’apprendre à lire et à écrire, elles participent aux réunions politiques et parlent pour la première fois dans des réunions.
La révolution est un flux continu. Et naturellement, ce ruisseau n’est pas toujours pur et clair ou capable d’éliminer toutes sortes de rouille et de saleté. Nous avons peut-être réduit les violences faites aux femmes dans notre collectivité, mais nous n’avons pas encore réussi à y mettre fin. La relation marquée par la crise entre les sexes de l’époque conduit à la corruption sociale. Comme l’a déclaré le dirigeant Apo, la maladie du pouvoir et de la hiérarchie se faufile à travers les fissures sociales et peut parfois entraver le fonctionnement du système confédéral démocratique. Par conséquent, il ne suffit pas d’assurer une sorte d’égalité approximative entre les femmes et les hommes. A moins que tous les domaines dans lesquels les femmes se trouvent ne soient remplis de liberté, les approches du pouvoir et de la force se reproduiront et se renforceront sur le dos des femmes.
Mais comment éliminer ces risques ? En d’autres termes, serons-nous capables d’exprimer l’ensemble de ces valeurs & le potentiel de liberté de notre lutte vieille de 40 ans (par exemple nos institutions, notre théorie et notre conscience, l’héritage de nos martyrs, etc.) dans un langage éthique et esthétique afin qu’il soit au service de la transformation sociale ?
C’est là qu’intervient la jineolojî (ou jinéologie). La jineolojî est là pour rechercher les conditions et les possibilités d’éclairer et de libérer les femmes en tant qu’essence et résidu de la société, au-delà de l’identité patriarcale imposée à la femme comme objet sexuel. C’est le nom de la transformation de la mentalité que nous essayons d’induire (même si les conditions de guerre et de violence ne le permettent pas toujours adéquatement), parce que nous croyons qu’avant que tout système puisse se matérialiser, il est d’abord établi dans le domaine de la mentalité. La jineolojî tisse le monde des mentalités pour accomplir les trois tâches suivantes :
Premièrement, exposer l’histoire de la colonisation des femmes. Expliquer les méthodes par lesquelles l’homme dominant a subjugué la femme et les moyens de résistance des femmes face à cette violence, y compris la recherche et l’exhumation des vestiges des cultures centrées autour de la matrice qui n’ont pu être effacés malgré les efforts colonisateurs. En d’autres termes, atteindre les cellules des racines pour guérir l’organisme malade, pour définir la dynamique de la révolution des femmes.
Deuxièmement, pour garantir la liberté des femmes. Pour ce faire, nous avons mis en place l’organisation et les institutions nécessaires, telles que nos structures d’autodéfense, notre système de coprésidence, nos académies, notre parti des femmes, ainsi que l’organisation séparée et autonome des femmes dans le domaine culturel, religieux, diplomatique, économique et autre. La jinolojî apportera un contenu fort à cela. Elle assurera la poursuite de notre révolution. Et troisièmement, conclure un contrat social avec les femmes pour une vie libre.
Revenons à la question de Leyla : Comment pouvons-nous inscrire notre héritage dans les pages de l’histoire ? En définissant ce que nous avons créé. Il y avait des distances entre l’existence et la conscience. Il y a eu des périodes où notre conscience était insuffisante ou où notre conscience était élevée, mais notre pouvoir nous manquait. La jineolojî comblera cet écart. Elle renforcera les piliers de la révolution des femmes.
Je veux terminer par une citation de Sakine Cansız :
« Il est probable qu’aucune autre révolution n’ait connu autant de révolutions à long terme, douloureuses mais réussies au sein de ses individus dans une telle mesure. Et c’est ici que nous trouvons la garantie de la victoire. L’humanisation du socialisme, l’effort, le travail et la patience pour le concrétiser dans chaque cellule vivante, se cristallisent dans notre lutte sublime. Pour cette raison, notre lutte est merveilleuse, attrayante et unificatrice. Je suis amoureuse de ce combat »