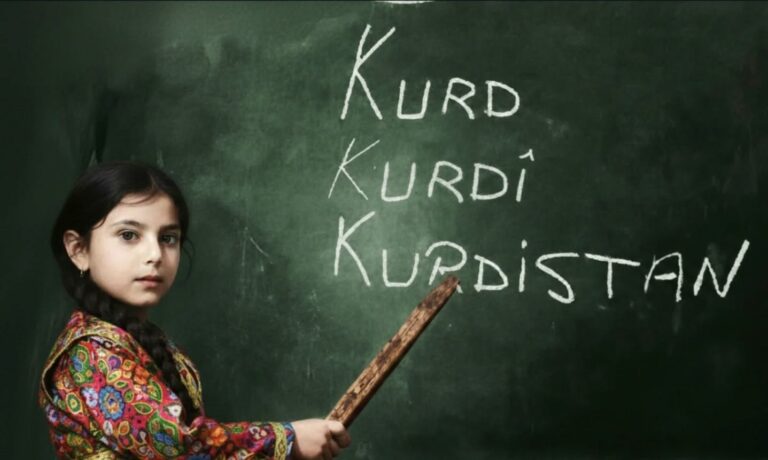SYRIE / ROJAVA – La délégation d’avocats affiliée à l’organisation MAF-DAT, qui a mené cette semaine une enquête sur les crimes de guerre commis contre le peuple kurde au Rojava, a publié une déclaration officielle. Dans cette déclaration, la délégation a souligné : « Les responsables de ces crimes doivent être tenus responsables devant les tribunaux internationaux. »

Le 22 février, une délégation d’avocats affiliés à MAF-DAT, en provenance de plusieurs pays européens, est arrivée au Kurdistan du Rojava afin de documenter les violations commises pendant la guerre. La délégation a visité plusieurs institutions de défense des droits humains et institutions politiques et a rencontré des blessés de guerre ainsi que des témoins des événements.
Après avoir terminé leurs investigations, ils ont tenu aujourd’hui une conférence de presse dans la ville d’Amuda, au cours de laquelle ils ont publié une déclaration publique.
Lors de la conférence, Ögmundur Jónasson, membre de la délégation et ancien ministre de la Justice islandais, a déclaré : « Le peuple du Rojava lance un appel à la justice internationale. J’aborderai deux points, le premier concernant la situation politique. Chacun sait que Kobani est assiégée, et lorsque Kobani est assiégée, c’est le monde entier qui est assiégé, car Kobani et le Rojava incarnent la résistance. Kobani résiste pour les droits humains et la démocratie. »
Il a poursuivi : « Nous sommes venus au Rojava pour rencontrer des représentants de l’Administration autonome et examiner la situation juridique sur place. Nous avons également rencontré de nombreux médecins et professionnels de divers domaines, ainsi que des avocats, et de nombreux témoins des événements. »
L’avocate Rengin Ergül a également rendu hommage au combat du peuple du Rojava et a déclaré : « Dans le cadre de notre mission de terrain indépendante dans les régions du nord et de l’est de la Syrie, nous avons rencontré des victimes de guerre, des personnes déplacées, des civils blessés, des professionnels de la santé et des représentants des institutions compétentes. Ce travail est mené de manière indépendante et conformément aux normes du droit international, en tant que mission d’établissement des faits. »
Elle a ajouté : « Aujourd’hui, j’aimerais partager notre évaluation selon cinq axes principaux. »
Justice et droits
Ergül a expliqué qu’ils partageraient leur rapport indépendant avec les mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme et les organismes et institutions compétents.
1. Les crimes relevant du Statut de Rome
Les documents recueillis nécessitent une évaluation approfondie, non seulement au regard du droit international des droits de l’homme, mais aussi au regard du droit pénal international.
Les attaques contre des civils, l’usage indiscriminé de la force, la destruction d’infrastructures civiles et les violations des institutions de santé peuvent être qualifiés de crimes de guerre ou, lorsque les conditions sont réunies, de crimes contre l’humanité en vertu du Statut de Rome.
L’évaluation juridique finale est sans aucun doute un processus long et complexe, mais notre mission est de documenter avec précision et objectivité, conformément aux normes internationales, les preuves indiquant ce niveau de violations.
2. Le silence de la communauté internationale
Ce qui est le plus fortement ressenti sur le terrain, ce n’est pas seulement la destruction matérielle, mais aussi le silence de la communauté internationale.
Les normes relatives aux droits de l’homme sont claires et contraignantes : la protection des civils, l’interdiction de la torture et la prévention des déplacements forcés sont autant de règles internationales générales.
Toutefois, l’absence d’un mécanisme international efficace et durable pour enquêter sur les violations engendre un sentiment d’injustice chez les victimes.
Le silence encourage l’impunité et renforce le sentiment d’un manque de responsabilité.
3. Manipulation des médias
Nos observations sur le terrain indiquent que l’information en situation de conflit peut être largement exploitée pour manipuler l’opinion publique.
Dissimuler la présence civile, brouiller la distinction entre cibles militaires et civiles, et parfois même accuser les victimes elles-mêmes sont des pratiques fréquentes.
Par conséquent, la documentation indépendante doit être objective et précise, et s’appuyer sur de multiples témoignages, des dossiers médicaux et des preuves matérielles. Une évaluation exhaustive des témoignages est essentielle.
4. Impunité antérieure et responsabilisation des auteurs de ces actes
Dans la mémoire collective de la communauté locale, il y a non seulement des violations actuelles, mais aussi de graves crimes passés pour lesquels justice n’a pas été rendue et dont les auteurs n’ont pas été tenus responsables.
Si la justice n’est pas effectivement rendue dans les affaires de crimes graves, cela risque d’ancrer une culture de violations systématiques. En droit international, l’impunité ouvre la voie à de nouvelles infractions.
Notre travail n’a pas pour but la vengeance, mais l’établissement d’une responsabilité légale fondée sur l’état de droit. La justice peut tarder, mais une documentation systématique est indispensable.
5. Un message selon lequel le peuple kurde n’est pas seul
La dimension humanitaire de cette visite réside dans le fait que chaque victime rencontrée ne souhaite pas seulement raconter son histoire, mais aussi être entendue.
La douleur et la souffrance du peuple kurde et de tous les civils de la région ne sauraient être ignorées. Les droits humains, sans discrimination fondée sur l’identité, appartiennent à tous.
Nous sommes ici non seulement pour documenter les violations, mais aussi pour révéler la vérité :
Dans le cadre de notre mandat, ces souffrances sont documentées.
Ces témoignages sont en cours d’enregistrement.
Ces dossiers ne seront pas clos.
(ANHA)