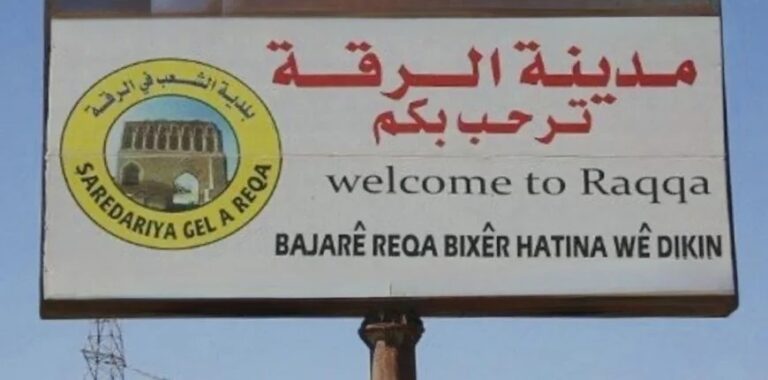« L’invasion des zones relevant de l’Administration autonome [du Nord et de l’Est de la Syrie] par les factions d’al-Amshat et de Hamzat… représente une dangereuse régression du droit des femmes à travailler, à participer et à se faire entendre. »
Emel*, qui a réussi à s’échapper à Qamishli de justesse, suit désormais avec une profonde inquiétude l’évolution de la situation à Raqqa. Pour les femmes comme elle – et pour tous ceux qui leur sont liés – le danger est immense. Par souci pour sa famille restée en ville, elle a choisi de garder l’anonymat. Si de nombreuses femmes ont publiquement arraché et brûlé leurs niqabs et abayas noires lors de la libération, les conséquences plus profondes de ces actes ne pouvaient être ignorées aussi facilement. Ensemble, elles ont fondé l’organisation de femmes arabes Zenobia , qui milite pour l’émancipation des femmes à travers des maisons de femmes, des coopératives et des initiatives éducatives. Aujourd’hui, tout ce que ces femmes ont construit risque à nouveau d’être anéanti. « L’invasion des zones relevant de l’Administration autonome [du Nord et de l’Est de la Syrie] par les factions d’al-Amshat et de Hamzat, et la privation des droits des femmes qui en découle, ne constituent pas un simple changement militaire ou administratif », explique Emel. « Il s’agit d’une dangereuse régression du droit des femmes à travailler, à participer à la vie politique et à faire entendre leur voix. » Au sein de Zenobia, Emel travaillait à la coordination régionale et aux efforts diplomatiques. Lorsque des factions armées alignées sur le gouvernement de Damas sont entrées à Raqqa, elle a été contrainte de fuir. « Nous avons quitté Raqqa après avoir été attaqués par des milices tribales. La situation est extrêmement grave, des milices arabes attaquent les Kurdes », raconte-t-elle. « Nous avons fui avec le dernier convoi et, en chemin, nous avons été attaqués à trois reprises. » Elle raconte que des civils ont été pris pour cible au dernier point de contrôle de Raqqa. À Sabah al-Khair, des voitures ont été attaquées, provoquant un massacre et de graves blessures parmi la population civile. Dans le village d’Umm Madfa, des civils ont de nouveau été attaqués depuis le sud. « La situation était catastrophique : il y avait des morts et des blessés. Une famille entière a été touchée, et trois ambulances du Croissant-Rouge kurde ont été prises pour cible. Une autre famille a été visée à un point de contrôle situé à 20 kilomètres de Khirbet al-Tamr. » Emel rapporte qu’à Tabqa et Raqqa, la distribution de vêtements « modestes » aux femmes a déjà commencé : « À Tabqa, les habitants ont commencé à porter des vêtements religieux conformes à la charia. » Elle ajoute qu’après le retrait des forces kurdes, « la région est passée sous le contrôle de l’État islamique. » La restriction des droits des femmes s’accompagne d’une augmentation des signalements d’attaques ciblées contre la population kurde et les personnes travaillant avec l’Administration autonome. « Des familles sont menacées et sommées de remettre leurs voitures et leurs armes personnelles », explique Emel. « Les gens disent qu’ils ne se sentent plus en sécurité. Ils gardent leurs portes verrouillées et n’osent plus les ouvrir. » Pour ne rien arranger, la situation est déjà critique et la nourriture vient s’ajouter aux pénuries, selon Emel. D’autres, qui ont collaboré avec l’Administration autonome, craignent des représailles et beaucoup cherchent désormais à fuir à Damas, « craignant des attaques contre leurs domiciles ou d’être dénoncés par des informateurs ». Parmi ses connaissances, une de ses collègues a récemment été contrainte de quitter son domicile à Tabqa et « a cherché refuge chez son oncle à Raqqa, où personne ne la connaît ». Elle rapporte également que des groupes mercenaires ont détruit et pillé des centres de Zenobia.Emel craint que les femmes ne soient à nouveau confinées exclusivement à leur domicile.
Malgré la relative sécurité qu’elle vit à Qamishli, Emel n’échappe pas à la peur, car sa famille est restée à Raqqa et certains de ses membres ont été menacés : « Hier, ils sont allés chez mon frère et lui ont ordonné de partir. Ils ont également menacé ma nièce et son mari. » Si l’impact concret sur les droits des femmes à Raqqa, Tabqa, Deir ez-Zor et Manbij – où Zenobia était auparavant active – reste incertain, Emel craint que les femmes ne soient à nouveau confinées exclusivement à leur domicile. Selon le nouveau gouverneur de Raqqa, Abdul Rahman Salama, le gouvernement syrien souhaite rétablir la stabilité et la sécurité dans la région et reconstruire les infrastructures de la ville. Cependant, les nouvelles autorités n’ont toujours pas abordé la question des attaques documentées contre des civils dans cette région, perpétrées par des forces islamistes. Au lieu de cela, elles accusent les FDS de crimes similaires. Pour l’instant, les activités de l’organisation féminine Zenobia sont suspendues dans la région. Pour Emel, cependant, ce n’est pas une raison de baisser les bras. Elle lance un appel à la communauté internationale afin qu’elle considère les femmes non seulement comme des victimes, mais aussi comme des partenaires pour la paix et la stabilité. « Nous ne demandons pas de privilèges, mais des droits fondamentaux : le droit d’être présentes, actives et en sécurité dans nos communautés. Exclure les femmes, c’est revenir à la logique de la violence plutôt qu’à celle de la justice, et au silence plutôt qu’à celle de la parole. » *Les noms ont été modifiés pour préserver la sécurité des personnes interviewées. Écrit par Isabel Krokat Article d’origine (en anglais) à lire ici : « No More Women’s Rights in Raqqa« Photo d’archive