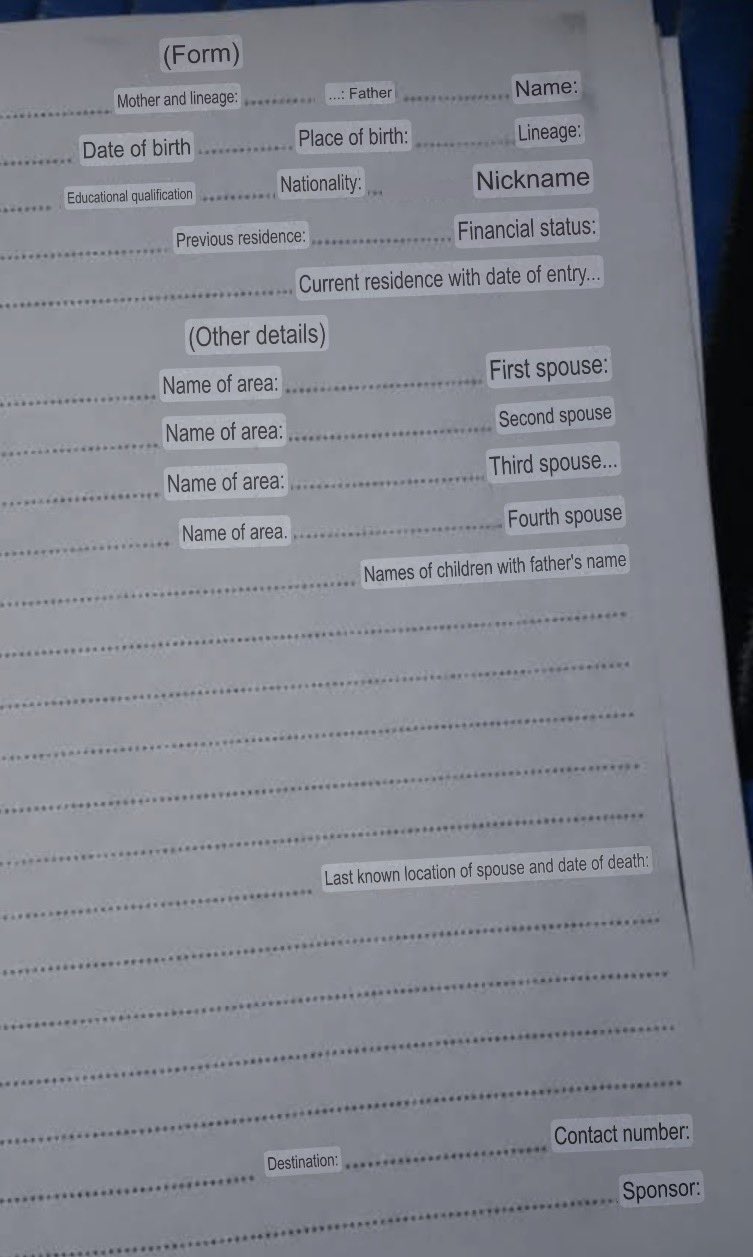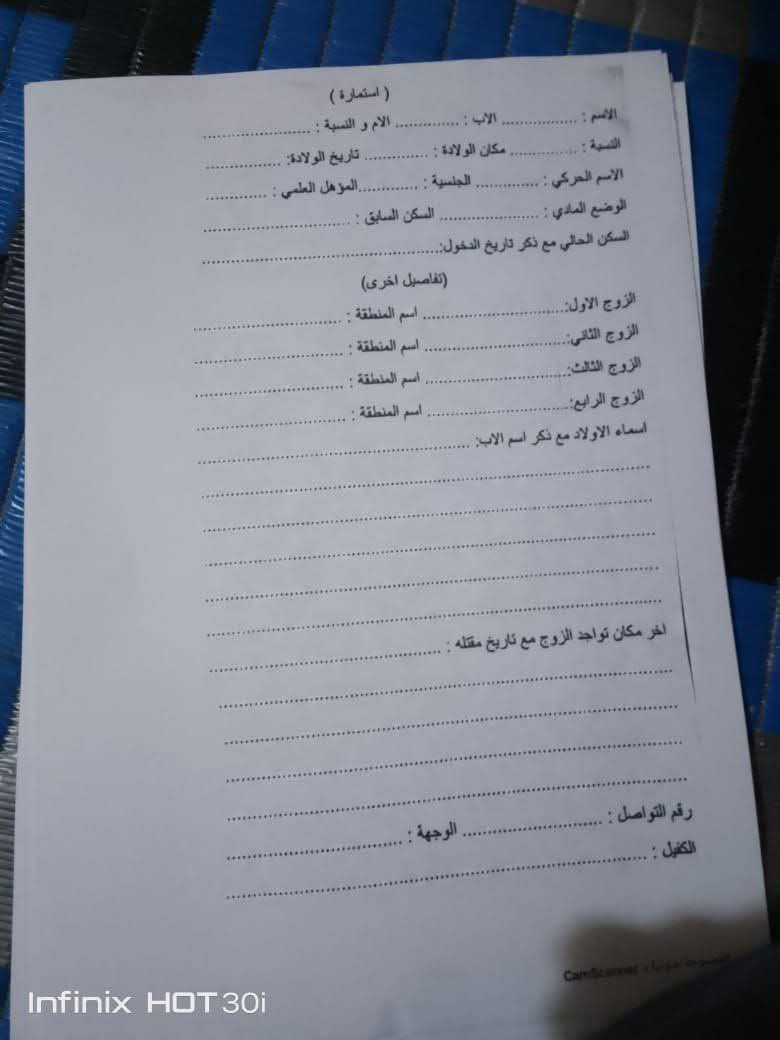Nous savons parfaitement ce que signifie le siège en cours au Rojava. Nous savons pourquoi les dernières attaques majeures ont débuté avec la table des négociations établie à Paris les 5 et 6 janvier 2026. Les puissances internationales réunies autour de cette table ont une fois de plus réduit l’existence des Kurdes à un problème technique à résoudre d’urgence, bafouant ainsi le droit de ce peuple à vivre librement. Lorsque le processus entamé par des manifestations pacifiques à Daraa le 15 mars 2011 en Syrie s’est transformé en guerre civile avec l’organisation des États et l’implication de groupes djihadistes, un espace de vie partagé, sans être impliqué dans ce crime contre l’humanité, a vu le jour au Rojava sous la direction des Kurdes, en collaboration avec les peuples et les communautés religieuses de la région.
Au Moyen-Orient, où des politiques de haine, de violence et de guerre ont été alimentées pendant des siècles par des différences ethniques et religieuses, un espace de vie alternatif, susceptible de transformer ces divisions, est systématiquement démantelé dans le silence des cercles diplomatiques. Tandis que l’attention du monde est focalisée sur d’autres crises, nous avons assisté au destin d’un peuple scellé par une banalité administrative quasi-administrative, sous couvert de « stabilité ». Ce moment marque le début d’une ère nouvelle où le droit international est relégué au second plan et où le pouvoir s’exprime désormais ouvertement et sans retenue.
Nous savons que ce qui s’est passé à Paris n’était pas un hasard. Cette scène illustre parfaitement le monde post-légal, où les puissants n’éprouvent même plus le besoin de se légitimer et où l’arbitraire est devenu une forme de gouvernement. Des représentants des États-Unis, d’Israël, du nouveau gouvernement syrien et de la Turquie étaient présents ; or, le plus frappant, alors que l’architecture régionale se redessinait, fut l’absence des Kurdes à la table des négociations. Nous savons également que cette absence n’était pas un oubli, mais un choix délibéré. Les Kurdes n’étaient pas l’objet de négociations ; ils étaient traités comme une variable à réprimer, à disperser ou à résoudre comme un problème « technique ». Il n’était pas question de justice ou de paix, mais d’une vague « stabilité » définie par chacun selon ses propres intérêts, et ce mépris pour les Kurdes est également significatif. Car dans la nouvelle Syrie qu’ils construiront ensemble, chacun a reçu sa part.
En réalité, nous savons que le peuple kurde n’est pas étranger à cette situation. Du traité de Sèvres à nos jours, il a maintes fois constaté que l’amitié des empires est toujours conditionnelle et que les sacrifices sont vite oubliés face à de nouvelles priorités stratégiques. Ce qui se dissout aujourd’hui, ce n’est pas seulement une structure militaire ou administrative ; c’est la conviction même que le droit et les droits universels, aussi souvent bafoués soient-ils, peuvent établir des limites. Pourtant, cette situation ne nous conduit pas au désespoir, mais nous éclaire à nouveau. Si les décisions prises à Paris témoignent de la brutalité du monde actuel, l’unité des Kurdes, toutes régions confondues, et leur résistance croissante constituent la réponse la plus forte. L’espoir né à Kobani en 2014 prend aujourd’hui un sens nouveau dans la résistance au Rojava, non seulement pour les Kurdes, mais pour tous les peuples du monde.
Face à cette réalité, les Kurdes et leurs amis occupent les rues et les places du monde entier depuis des jours. Ici, cette mobilisation revêt une signification qui dépasse largement la simple solidarité avec un lieu ou une zone géographique éloignée. Cette solidarité est l’expression de notre engagement indéfectible envers l’idéal d’une vie meilleure grâce au Rojava, et envers la conscience de l’humanité, pour celles et ceux dont la voix est réduite au silence par des systèmes dominants, militaristes et racistes. Nous sommes témoins de manifestations très précieuses de cette solidarité. Nous savons, par expérience, combien il est important de disposer d’informations exactes et de les diffuser face aux campagnes de désinformation anti-kurdes orchestrées par des États qui détiennent le monopole de la violence, de la logistique et de la haine.
L’effet boule de neige de la pratique
Ici, nous observons de près comment chaque parole, chaque action, qu’elle provienne d’artistes, d’écrivains, de journalistes, de scientifiques, de politiciens ou de militants, crée un effet boule de neige. La conscience de l’humanité qui se mobilise pour le Rojava marque l’histoire et continue de le faire. Je souhaite vous en faire part à quelques reprises. Un groupe se faisant appeler la « Délégation pour la Paix » a lancé un appel urgent pour Kobani. Dans une déclaration commune signée par plus de 100 artistes, journalistes, avocats et collectifs d’ Europe , de Turquie et de la région kurde, il a été souligné que les coupures d’eau et d’électricité persistantes à Kobani constituent une violation flagrante du droit international humanitaire. La déclaration a mis en lumière le lien entre la politique transfrontalière de la Turquie et les attaques ainsi que l’occupation de facto exercée par Hayat Tahrir al-Sham (HTS). J’ai perçu l’artiste kurde Hogir Ar au cœur de cette action.
Alors que les campagnes internationales et les appels à la solidarité avec le Rojava se poursuivent, un nouvel appel a émergé de France. Publié dans deux quotidiens français, Libération , cet appel souligne que les attaques systématiques contre les femmes kurdes au Rojava visent la révolution féministe et que le silence de la communauté internationale équivaut à de la complicité. Au cœur de ce texte, qui clame « Ne restons pas silencieux face au meurtre des femmes kurdes ! », je reconnais la féministe, scientifique et militante Pınar Selek. Publié sous le titre « Ne sacrifions pas ce peuple, ces femmes, cet espoir », cet appel insiste sur le fait que le modèle de vie libéral et démocratique construit sous l’impulsion des femmes au Rojava est la cible d’attaques de groupes djihadistes. Le texte affirme que les féminicides, les enlèvements, la torture et les violences sexuelles contre les femmes sont devenus systématiques.
Deux autres appels de ce type ont été relayés aujourd’hui par les portails d’information. L’un d’eux provient de France, où le quotidien Le Monde a publié une tribune signée par plus de 400 personnalités appelant à la défense du Rojava. En consultant les signatures de cet article intitulé « Appel à défendre le Rojava en Syrie » , on découvre des centaines de noms, allant d’universitaires et de politiciens à des juristes et des écrivains issus des universités françaises. Parmi ceux qui viennent immédiatement à l’esprit, citons Hamit Bozarslan, Engin Sustam, Gilbert Mitterrand et Zerrin Bataray.
La dernière déclaration de solidarité que je souhaite partager nous vient du Royaume-Uni. De nombreux intellectuels, écrivains, artistes et universitaires, parmi lesquels le prix Nobel J.M. Coetzee, l’acteur de renommée mondiale Stephen Fry et le président de PEN International, Burhan Sönmez, ont appelé la communauté internationale à mettre fin au conflit en Syrie, à reconnaître les droits des Kurdes du Rojava et à résoudre les problèmes par des moyens pacifiques. Dans cette déclaration commune, publiée sous le titre « Appel pour le Rojava », il est souligné que la guerre qui ravage la Syrie depuis des années a engendré d’immenses souffrances humaines et que le processus de démocratisation tant espéré pour cette nouvelle ère a été entravé par les politiques unilatérales et autoritaires du gouvernement arrivé au pouvoir, politiques qui s’opposent aux minorités. Je tiens à mentionner ici le nom de l’écrivain Burhan Sönmez.
Alors que je m’apprêtais à terminer la rédaction de ces lignes, un autre appel à la solidarité similaire a été publié : plus d’une centaine de personnes, parmi lesquelles des retraités, des étudiants, des enseignants, des agriculteurs, des infirmières, des chômeurs, des bibliothécaires, des doctorants et des ingénieurs, ont publié une déclaration dans le quotidien français L’Humanité, intitulée : « Urgent ! La révolution au Rojava et son projet social de libération sont en danger de mort ! En tant que syndicalistes, nous devons agir . » Cette déclaration, signée par plus d’une centaine de syndicalistes, affirme : « Le 26 janvier, date anniversaire de la libération de Kobanê de Daech par les forces kurdes en 2015, la ville et le projet social de libération en cours de développement au Rojava sont à nouveau menacés. En réponse, une initiative a émergé au sein du mouvement syndical », appelant au renforcement des mobilisations solidaires et exhortant les organisations syndicales à tous les niveaux à prendre leurs responsabilités et à devenir les organisatrices et les actrices de ces mobilisations.
Diplomatie de l’information
Ces appels et campagnes constituent de précieux exemples de solidarité face à la désinformation alimentée par la haine, la violence et les conflits, propagée par les autorités étatiques. Diffuser des informations exactes dans le cadre d’une diplomatie de l’information, et encourager et renforcer la solidarité entre les femmes, les artistes et les universitaires, est essentiel pour soutenir le Rojava. Car le siège que subit le Rojava n’est pas seulement militaire et armé, mais aussi une guerre de l’information, une guerre psychologique sordide. Dans ce contexte, il est primordial de prendre position pour l’humanité et de l’affirmer par les mots et par les actes.
C’est précisément pourquoi, aujourd’hui, la solidarité avec le Rojava dépasse largement la simple « sympathie » ou une réaction de conscience face à une tragédie observée de loin. Cette solidarité est une affirmation de notre position dans un monde où l’État de droit est suspendu, les droits bafoués et le destin des peuples scellé à huis clos. Être solidaire du Rojava, c’est défendre la libération des femmes, l’égalité des peuples, la coexistence et un avenir démocratique et pluraliste. Ce qui est visé au Rojava aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les Kurdes ; c’est la possibilité d’une autre vie, d’une autre vision politique, d’un autre espoir pour le monde.
Notre appel est donc clair : le Rojava n’est pas seul et ne doit pas l’être. Nous devons rendre ce siège visible dans les rues, sur les places publiques, dans les universités, les syndicats, les milieux culturels et artistiques, les médias et les plateformes numériques, et briser le mur du silence érigé par les États. Chaque déclaration, chaque signature, chaque événement, chaque écrit, chaque action, chaque graffiti sur les murs : tout cela témoigne de la volonté du peuple face aux décisions prises dans l’obscurité des couloirs diplomatiques. Il est essentiel aujourd’hui de multiplier, de relier et de pérenniser ces manifestations de solidarité, en apparence éparses.
S’exprimer pour le Rojava, ce n’est pas seulement défendre un peuple ; c’est défendre l’avenir. C’est défendre la liberté bâtie sous l’égide des femmes, la volonté des peuples de s’unir et le courage collectif face à la tyrannie. C’est pourquoi chacun peut agir, où qu’il soit : diffuser des informations exactes, dénoncer les mensonges, organiser la solidarité et amplifier les paroles et les actions contre l’oppression. Car la résistance du Rojava est aussi notre résistance à préserver notre humanité.
Aujourd’hui, nous le déclarons une fois de plus, haut et fort : si le Rojava tombe, l’humanité perd. Si le Rojava survit, l’espoir survit.
Par conséquent, renforçons et pérennisons notre solidarité avec le Rojava. Lorsque l’histoire sera réécrite, ce sont ceux qui ont résisté, et non ceux qui sont restés silencieux, qui seront remémorés.