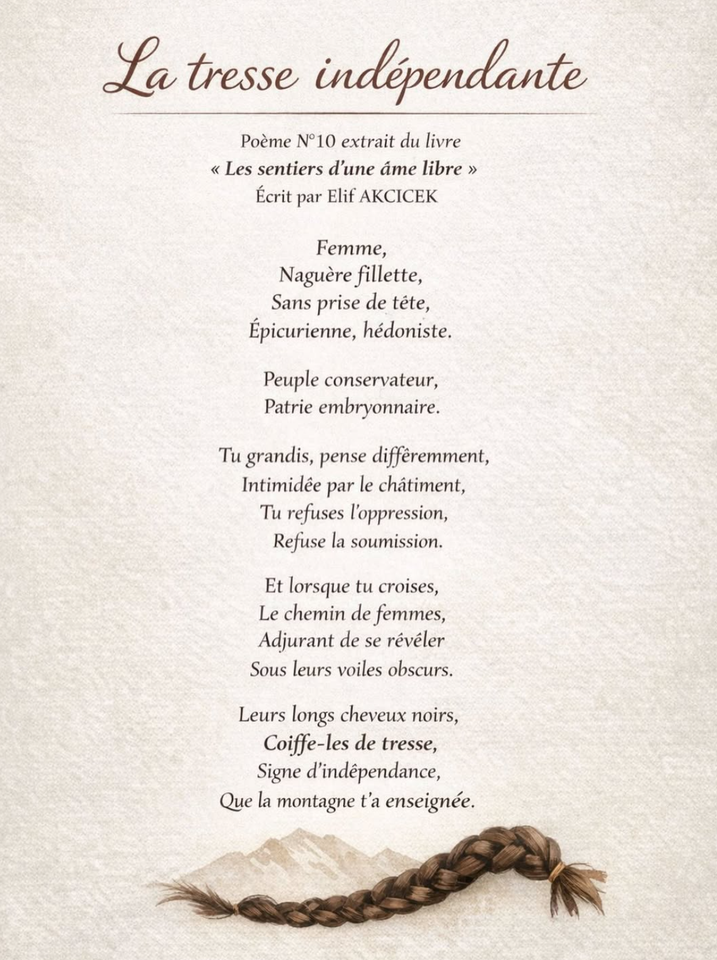
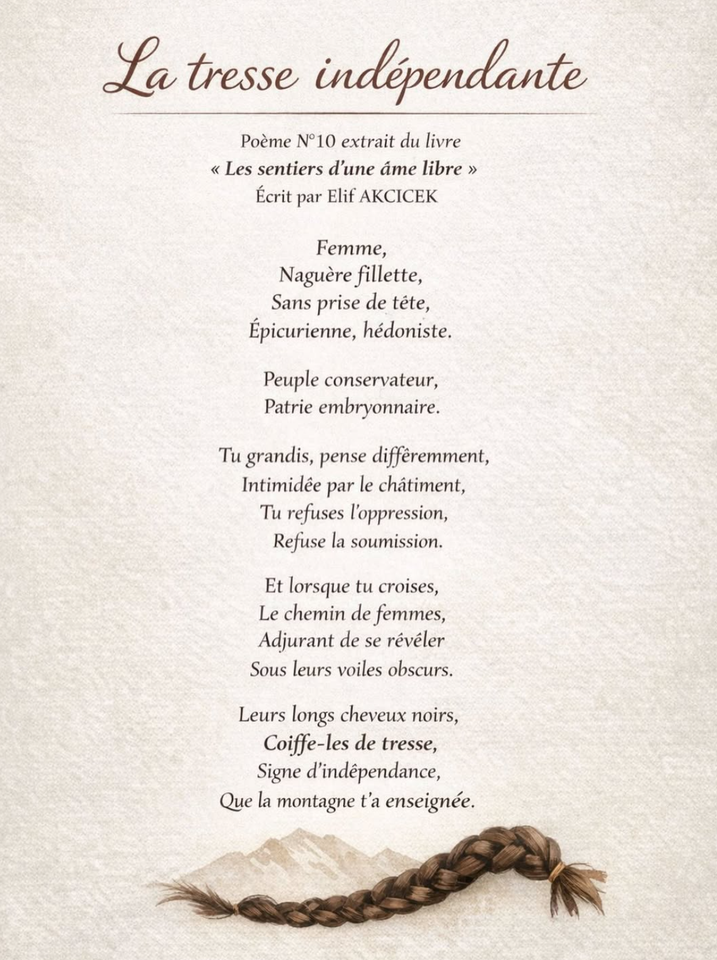
IRAN – Selon de nombreuses sources, les Gardiens de la révolution iraniens ont transféré des prisonniers politiques de la prison d’Evin vers des installations militaires. Parmi les prisonniers transférés pour être utilisés comme « boucliers humains » figurent des femmes, des mineurs et des Kurdes.
Les Gardiens de la révolution iraniens sont accusés de transférer des prisonniers politiques de la tristement célèbre prison d’Evin vers des installations militaires afin de les utiliser comme boucliers humains en cas d’attaques potentielles. Des informations et des vidéos à ce sujet ont circulé dimanche sur la plateforme X (ancien Twitter). Selon ces informations, les personnes concernées seraient des manifestants arrêtés lors de manifestations anti-régime en Iran et au Rojhilat (Kurdistan d’« Iran »). De nombreuses femmes et des mineurs figureraient également parmi les prisonniers.
Des militants accusent les Gardiens de la révolution de transférer délibérément des prisonniers dans des centres militaires afin de protéger leurs propres installations contre d’éventuelles attaques. Cette accusation repose sur l’hypothèse, avancée par Téhéran, que les États-Unis et Israël attaqueraient des cibles militaires mais épargneraient des installations civiles abritant des femmes et des enfants.
Si ces allégations étaient confirmées, il s’agirait d’une grave violation du droit international humanitaire. L’utilisation de prisonniers et de civils comme boucliers humains est interdite par le droit international. De nombreux internautes ont vivement critiqué ces allégations et exigé une intervention immédiate des organisations internationales pour protéger les prisonniers. Ils ont averti que la situation faisait peser une menace grave sur la vie des personnes concernées.
Auparavant, le Comité pour la liberté des prisonniers politiques avait déclaré que l’administration de la prison d’Evin s’était effondrée durant la guerre d’agression israélo-américaine. Le personnel avait déserté, les structures organisationnelles étaient paralysées et les cellules étaient verrouillées. De ce fait, des milliers de détenus vivaient dans une situation d’insécurité extrême. L’accès à l’eau potable, aux soins médicaux et à l’hygiène de base n’était plus garanti. (ANF)
SYRIE / ROJAVA – Depuis 20 janvier, la ville kurde de Kobanê est assiégée par les factions armées affiliées à la Turquie et à Damas qui la privent de l’eau potable, de l’arrivée de la nourriture, de médicaments et les enfants de l’éducation car les écoles sont transformées en abris pour les réfugiés…
Le siège de Kobanê, ville kurde de l’ouest du pays, se poursuit sans relâche depuis 41 jours. La ville est assiégée depuis le 20 janvier par les troupes et les milices du gouvernement intérimaire syrien et des groupes paramilitaires soutenus par la Turquie.
Bien qu’une désescalade ait été envisagée le 29 janvier dans le cadre d’un accord entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) et les autorités de Damas, le siège n’a pas encore été levé. Aucune mesure concrète visant à lever le blocus n’est actuellement prévue.
Avec le début de la vague d’attaques contre les autorités autonomes, de nombreux habitants de Tabqa, Raqqa et Alep ont fui vers Kobané en janvier. La population de la ville dépasserait désormais les 600 000 habitants. Cet exode massif contribue à aggraver une situation déjà tendue.
Dans le contexte du siège, les pénuries de nourriture, d’eau potable, de carburant et de fournitures médicales sont criantes. L’hébergement des réfugiés représente également un défi immense. Les hôpitaux fonctionnent dans des conditions difficiles, et l’aide humanitaire n’atteint la ville que partiellement, voire pas du tout.
Les représentants des organes d’autonomie locale évoquent une crise humanitaire qui s’aggrave. Sans une réouverture rapide des points d’accès et la mise en œuvre du mécanisme de sécurité convenu, la situation risque de se détériorer. (ANF)
IRAK – Selon l’universitaire franco-kurde, Hardy Mède, en cas d’effondrement du régime iranien, le paysage milicien chiite d’Irak subira une recomposition majeure, avec des perdants et des gagnants.
Des formations telles que Noujaba, le Hezbollah irakien ou encore Kataïb Sayyid al-Shuhada auraient probablement de grandes difficultés à subsister en cas de disparition de la République islamique d’Iran.
IRAN / ROJHILAT – Suita aux frappes aériennes de ce matin, la ville kurde de Mahabad, dans la province d’Azerbaïdjan occidental, n’a plus d’électricité. On ne sait pas si la coupure a été provoquée par les bombardements ou sur ordre du régime iranien.
L’électricité a été totalement coupée dans toute la ville de Mahabad suite aux frappes aériennes américaines et israéliennes de grande envergure menées lundi matin 2 mars 2026, qui ont ciblé des positions et des institutions de la République islamique, notamment le département du renseignement dans la ville, selon les informations reçues par l’ONG Hengaw. On ignore encore si la coupure a été imposée par un ordre gouvernemental ou si elle a été causée directement par le bombardement.
KURDISTAN – Alors que les tensions entre l’Iran, les États-Unis et Israël atteignent un point de non-retour, le Rojhelat (Kurdistan « iranien ») et le Başur (Kurdistan « irakien ») sont redevenus le principal champ de bataille. Des sommets des monts Shaho aux rues d’Erbil (Hewler), le bruit des explosions marque une période difficile pour une région prise au piège d’un conflit mondial.
Dans une vague massive de frappes aériennes, des sites militaires situés dans quatre provinces de l’ouest de l’Iran ont été visés. L’objectif de ces frappes était de détruire les capacités iraniennes en missiles et en drones.
Quelques heures après les attaques sur son sol, l’Iran a riposté en frappant des cibles dans la Région du Kurdistan d’Irak.
L’Iran a visé les bases des groupes d’opposition kurdes iraniens en Irak, affirmant qu’ils aident Israël :
Début 2026, au milieu des attaques de Damas ciblant l’autonomie des Kurdes du Rojava, la coalition internationale dirigée par les États Unis a transféré des milliers de membres de l’État islamique, dont des Turcs, de Syrie vers l’Irak, avec perspective de rapatriement en Turquie. Ces mouvements obligent les deux pays à affronter leurs failles judiciaires : procès expéditifs, accusations vagues, risques de torture et impunité persistante pour les crimes de l’EI, notamment le génocide yézidi. La Turquie et l’Irak pourront-ils enfin rendre justice ou perpétuer l’impunité ? Dans l’article suivant, la journaliste Rengin Azizoğlu soulève de nombreuses questions relatives au suite judiciaire que la Turquie et l’Irak pourront réserver aux membres de l’État islamique (EI ou DAECH / ISIS).
Le récent transfert de militants de l’EI des prisons du nord de la Syrie vers l’Irak, ainsi que les discussions sur d’éventuels rapatriements en Turquie, ont relancé des questions essentielles sur la manière et le moment où ces individus seront de nouveau traduits en justice.
D’après un reportage de la journaliste Hale Gönültaş, basé sur des observations de terrain et des sources diplomatiques, le transfert d’un nombre important de combattants de l’EI, dont des citoyens turcs, est achevé. Les opérations d’identification et d’interrogatoire seraient en cours en Irak, après quoi un rapatriement pourrait être envisagé pour ceux dont la citoyenneté est confirmée.
Les accords d’extradition existants entre la Turquie et l’Irak pourraient être invoqués, mais tout retour serait soumis à une série de vérifications et de procédures judiciaires, et non immédiat. Bien qu’Ankara, Bagdad et Washington soient parvenus à un accord de principe, les détails restent flous et des informations contradictoires laissent penser que le processus est toujours en cours de négociation.
Obligations de l’État en matière de rapatriement
En droit international, il n’existe aucune obligation explicite de rapatrier les citoyens détenus dans des zones de conflit. L’expert en droit international Güley Bor a toutefois souligné que les cadres relatifs aux droits de l’homme peuvent, dans certaines circonstances, exiger le rapatriement afin de garantir le droit à la vie ou l’interdiction de la torture.
Cet argument est particulièrement pertinent lorsque des enfants sont concernés. Si le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a exhorté à la restitution des mineurs détenus dans les camps syriens, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a statué que les États n’ont pas d’obligation générale de rapatrier leurs citoyens.
Ces positions contradictoires, a souligné Bor, illustrent la dimension politique des questions juridiques. « Puisque ces questions litigieuses en droit international sont également influencées par la pratique des États, les décisions politiques – comme l’annonce de l’Australie de ne pas rapatrier ses citoyens transférés en Irak – auront une incidence déterminante sur la reconnaissance finale d’une telle obligation », a-t-elle déclaré.
L’option de poursuites en Irak
Poursuivre les militants de l’EI en Irak est juridiquement possible, mais extrêmement problématique. Bor souligne que le système judiciaire irakien soulève de graves préoccupations quant au droit à un procès équitable, notamment en raison d’allégations de torture, de condamnations expéditives et de recours à la peine de mort.
Bor a souligné que le génocide et les crimes contre l’humanité ne sont pas définis dans le code pénal irakien. « De ce fait, les poursuites sont engagées sous de vagues accusations de terrorisme », a-t-elle déclaré. « Le génocide yézidi, par exemple, ne serait pas reconnu. Il en résulte un système judiciaire qui ne répond pas aux exigences de la justice. »
Les listes d’identification fournies par l’Irak pourraient, en théorie, permettre à la Turquie d’engager des poursuites, mais en pratique, des blocages judiciaires persistent. Comme l’a souligné l’avocat Senem Doğanoğlu, une fois ces éléments officiellement transmis, « le système judiciaire ne pourrait plus légitimement prétendre ne pas pouvoir poursuivre ; la procédure dépendra de la capacité des autorités politiques et judiciaires à transformer ces informations en une véritable enquête criminelle. »
Doğanoğlu a évoqué des cas antérieurs où les autorités turques avaient affirmé qu’« aucun document de ce type n’avait été trouvé », malgré la présence de preuves dans les bases de données des tribunaux irakiens. « Il s’agit d’un blocage judiciaire, et cela laisse déjà présager ce qui pourrait se produire à l’avenir », a averti l’avocat.
Les limites des poursuites fondées uniquement sur l’« appartenance à une organisation terroriste »
L’une des principales préoccupations est que le renvoi des suspects d’appartenance à l’EI en Turquie risque de ne pas aboutir à une véritable responsabilisation. Dans les affaires précédentes, les poursuites se sont souvent limitées à l’accusation d’« appartenance à une organisation terroriste », une pratique systématique que les critiques qualifient d’approche de poursuite généralisée.
« La réduction des dossiers à la seule accusation d’« appartenance à une organisation terroriste armée » est devenue une pratique judiciaire prévisible », a déclaré Doğanoğlu. « Les tribunaux ne définissent ni l’EI comme une organisation commettant des crimes contre l’humanité, ni n’évaluent les massacres dans ce cadre. »
En réduisant les affaires d’atrocités complexes à une simple appartenance à une organisation plutôt qu’en poursuivant des accusations telles que crimes contre l’humanité ou génocide, le processus judiciaire risque de minimiser l’ampleur et la gravité des infractions présumées. Doğanoğlu souligne que lorsque les actes d’accusation sont formulés de manière restrictive, les détails des atrocités risquent d’être effacés des archives, ce qui réduit la responsabilité des auteurs.
Pour Doğanoğlu, le problème dépasse toutefois la simple requalification des crimes en infractions graves et relève d’une tolérance institutionnelle. « Cette tolérance systématique envers Daech se reproduit à chaque étape du processus judiciaire, de la collecte des preuves à leur évaluation », a-t-elle déclaré.
Doğanoğlu souligne un autre risque lié à la prescription. Si les crimes contre l’humanité ne sont pas soumis à un délai de prescription, les poursuites fondées sur des accusations d’appartenance à une entité juridique peuvent finir par expirer, ce qui a pour effet de « les enterrer sous le voile du silence juridique ».
Complexité des cas concernant les femmes et les enfants
Les femmes et les enfants constituent un aspect particulièrement complexe et peu étudié du processus de rapatriement. Doğanoğlu a constaté que la pratique judiciaire en Turquie tend de plus en plus à considérer les femmes comme des « victimes passives », même lorsque des preuves attestent de leur implication dans les activités de l’État islamique.
« Les récits choisis par les femmes ont révélé qu’elles étaient des auteures de ces actes. Le fait d’avoir reçu une formation à l’utilisation d’armes et de gilets explosifs, et d’avoir visionné des vidéos de massacres à des fins de propagande, témoigne d’une complicité dans ces crimes », a-t-elle déclaré.
Les enfants, en revanche, sont avant tout considérés comme des victimes. Bor souligne que les enfants élevés dans des camps sous l’influence d’adultes affiliés à l’EI ne doivent pas être traités comme des délinquants, mais comme des victimes de radicalisation. Elle insiste sur le fait que le soutien psychosocial est essentiel à leur réhabilitation et que les politiques doivent être guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant.
La journaliste Gönültaş a partagé des exemples concrets tirés d’observations de terrain, soulignant comment de jeunes enfants radicalisés et armés, suivant un programme de réhabilitation, rencontrent des difficultés à s’adapter pleinement à la vie civile :
« En 2018, plusieurs enfants ont été amenés en Turquie avec le consentement de leurs mères. Ils avaient environ cinq à six ans. Parmi eux, certains avaient reçu un entraînement djihadiste, savaient manier les armes et avaient appris à tuer. Leur turc était rudimentaire et ils préféraient parler arabe. Ils ont suivi de longs programmes de réhabilitation, mais il est difficile d’affirmer qu’ils se soient pleinement adaptés à leur nouvelle vie. »
L’absence de politiques de réintégration systématiques demeure un défi majeur. Gönültaş observe : « La Turquie ne dispose pas d’un programme clairement structuré pour la réhabilitation des groupes radicalisés. La nature du programme de réintégration qui sera mis en œuvre reste incertaine. »
Mémoire collective et l’ombre du 10 octobre
Une éventuelle procédure de rapatriement pourrait avoir des conséquences qui dépassent le simple déclenchement de nouveaux procès. Elle met également en lumière le massacre d’Ankara du 10 octobre 2015, un double attentat-suicide perpétré lors d’un rassemblement pour la paix, qui a fait plus de 100 morts et des centaines de blessés, ce qui en fait l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire turque.
L’attentat et ses conséquences restent un moment marquant de la mémoire collective turque, soulevant des questions sur la façon dont les auteurs ont pu rester en fuite pendant des années et sur la responsabilité de l’État pour que justice soit rendue.
Doğanoğlu souligne les implications plus larges : « Le 10 octobre est le plus grand massacre de masse perpétré en un seul moment dans l’histoire récente de la Turquie. Le retour des accusés en fuite ne signifierait pas seulement la poursuite de quelques individus ; il signifierait la levée du voile sur la période sombre de 2015. »
En définitive, le débat sur le rapatriement ne saurait se réduire à une simple question de sécurité. Il permettra de déterminer si la Turquie est capable d’aborder de manière constructive ses dossiers relatifs à l’État islamique, si l’impunité persiste et quel cadre juridique et politique régira le traitement de ces crimes.
Article (en anglais) à lire sur le site The Amargi « As ISIS Detainees Are Transferred, Turkey and Iraq Face Reckoning Over Justice and Impunity«
Le journaliste kurde, Maxime Azadî critique les positions anti-impérialistes de la gauche, jugées irréalistes et incapables de proposer des solutions concrètes face à la brutalité des régimes oppressifs comme celui de l’Iran, soulignant l’inefficacité du droit international, qui protège davantage les États puissants que les peuples, et l’absence de réponse viable pour sauver les Iraniens, Kurdes ou Baloutches malgré leurs tentatives de libération…. sans parler de Khamenei dépeint par certains comme une figure quasi divine qui était pourtant une « machine de mort » responsable d’exécutions quotidiennes contre diverses minorités et opposants à travers l’Iran mais aussi à l’étranger.
Maxime Azadî a écrit :