Un regard critique sur l’essai de Dilar Dirik sur le mouvement des femmes kurdes.
Nous connaissons tous l’image orientalisée et fétichisée de la femme guerrière kurde qui se bat contre DAECH. Un peu amazone, un peu Angelina Jolie, elle est trop facilement aseptisée, occidentalisée et extraite de son contexte dans le mouvement militant de libération kurde dirigé par des femmes. Dans The Kurdish Women’s Movement: History, Theory, Practice, l’universitaire kurde Dilar Dirik cherche à approfondir et à compliquer cette image, en plaçant ce mouvement dans le contexte de décennies d’une « histoire » en dents de scie, souvent négligée, d’une « théorie » historique et sociologique unique et d’une « pratique » qui prétend toucher la vie de millions de femmes dans tout le Moyen-Orient.
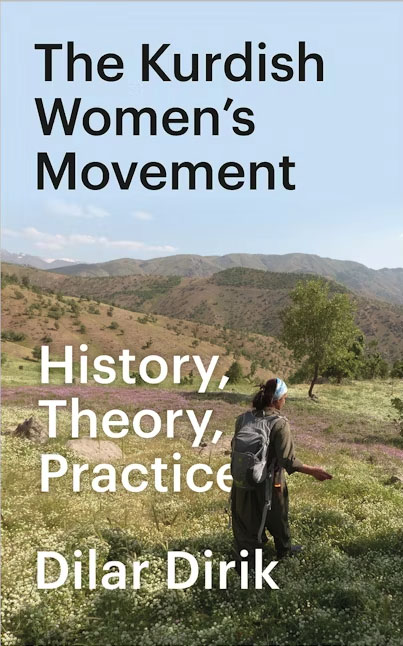
Écrivant à partir d’une position de sympathie personnelle et politique admise pour le mouvement mené par le leader politique kurde emprisonné Abdullah Öcalan et son Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Dirik critique ce qu’elle appelle la pratique standard consistant à contrebalancer « l’engagement superficiel avec les écrits d’Öcalan par des impressions ethnographiques de type instantané ou des articles d’actualité sur la pratique du mouvement ». Le travail de la boursière de l’Université d’Oxford cherche plutôt à prendre le mouvement au sérieux dans ses propres termes, en comblant le fossé entre les récits trop enthousiastes attribuant aux Kurdes une propension surhumaine à la révolution, et les analyses normatives réductrices rédigées d’un point de vue purement académique.
À ce titre, il convient d’évaluer dans quelle mesure la prétention du mouvement à offrir une alternative systémique aux États-nations autoritaires et à l’organisation sociale patriarcale, tribale ou nucléaire se vérifie sur son plus grand terrain d’expérimentation à ce jour – la politique dirigée par les Kurdes dans le nord et l’est de la Syrie (NES), construite autour du cœur kurde connu sous le nom de Rojava, où une administration civile a passé la dernière décennie à tenter de mettre en œuvre les idéaux du mouvement des femmes. Dirik aborde également la portée du mouvement kurde dans la Turquie peuplée de Kurdes et, dans une moindre mesure, en Irak.
Alors que le Kurdistan est une nation sans État qui couvre une partie de la Turquie, de la Syrie, de l’Irak et de l’Iran, il n’y a pas de chapitre entier consacré au mouvement des femmes en Iran, mais les idées du mouvement sont également présentes au sein de la minorité kurde de ce pays, comme en témoignent les récents soulèvements qui ont suivi la mort de Jina (Mahsa) Amini, à la suite desquels le slogan du mouvement kurde « Jin, Jiyan, Azadî » (« Femmes, Vie, Liberté ») a résonné dans le monde entier.
Mais c’est dans le NES que la vision optimiste et transformatrice d’une « lutte paradigmatique contre la modernité capitaliste » promue par Dirik est mise à rude épreuve – comme j’ai pu le constater moi-même au cours des trois années que j’ai passées à vivre et à faire des reportages dans cette région appauvrie, en proie à des difficultés et politiquement compromise.
Comme le souligne Dirik, le mouvement kurde n’est pas apparu du néant avec l’établissement d’une autonomie de facto au Rojava à la suite du déclenchement de la guerre civile syrienne, et la rapide montée en puissance de cette région au cours de la guerre contre DAECH. Le PKK est plutôt entré sur la scène politique en tant que guérilla marxiste-léniniste clandestine luttant pour un État kurde indépendant et socialiste – une guérilla caractérisée par la participation exceptionnellement large et de plus en plus active de cadres féminins. La reconnaissance croissante de la nécessité d’une organisation politique dirigée par des femmes a été précipitée par un changement marqué dans l’analyse politique d’Öcalan, en particulier après sa capture en 1999 par les forces de sécurité turques, ce qui a entraîné une réévaluation de la stratégie du PKK.
En cherchant à prendre au sérieux les contributions intellectuelles du mouvement kurde et de son leader, Dirik minimise parfois l’impact des circonstances et de la realpolitik sur l’évolution inattendue du mouvement. L’évolution d’Öcalan vers un système d’organisation fédérale, décentralisée et à double pouvoir était au moins en partie motivée par l’impossibilité admise d’établir un État kurde, et le fait d’admettre ce fait ne diminue en rien l’importance des réalisations ultérieures du mouvement dans cette direction.
De même, il est pratiquement impossible de réconcilier la description faite par Dirik d’Öcalan comme un dépositaire bienveillant du savoir, particulièrement sensible aux luttes des femmes, se levant tôt pour offrir des fleurs aux militantes lors de la Journée internationale de la femme, avec l’image présentée, par exemple, par Aliza Marcus dans sa propre histoire critique du mouvement kurde (largement basée sur les récits d’anciens membres du parti désillusionnés), dans laquelle Öcalan est représenté comme un homme imbu de sa personne et calculateur. Il est probable que la vérité se situe quelque part entre les deux.
Quoi qu’il en soit, il est plus intéressant de reconnaître, comme le fait Dirik, l’idéal émancipateur que représente Öcalan pour des millions de femmes kurdes, étant donné sa représentation claire et cohérente des femmes comme la « première colonie » qui doit être libérée avant que le reste de la société ne puisse suivre. Les femmes kurdes sont toujours à l’avant-garde de toute manifestation au Kurdistan réclamant la libération d’Öcalan et, bien que leur dévouement à une figure de proue masculine puisse sembler contradictoire aux yeux des féministes occidentales, il ne peut être ignoré avec désinvolture.
Dans l’abstrait, la « science des femmes » sociologique connue sous le nom de « Jineolojî » ou « Femme-ologie » semble vague et légèrement New Age dans sa critique de la hiérarchie masculine. Mais il s’agit d’une science dans le même sens hautement politisé que le marxisme-léninisme se présente comme une « science » – une prétention épistémique à placer un groupe réprimé au centre de l’organisation sociale. En présentant leXXIe siècle comme le siècle de la « révolution des femmes », le mouvement kurde dit aux femmes qu’elles sont le pivot de l’histoire et de l’organisation sociale, tout comme les marxistes disaient autrefois aux ouvriers industriels qu’ils détenaient les clés de l’histoire, ou comme les nationalistes arabes cherchaient à exploiter le pouvoir de masse de leurs propres peuples réprimés.
À cette fin, la contribution intellectuelle du mouvement des femmes kurdes devrait plutôt être évaluée en fonction de sa capacité à « communiquer des idées et des débats intellectuels aux mouvements opprimés et dépossédés ». Il est facile de reconnaître la nature politisée des théories d’Öcalan sur l’histoire, mais sa « science » a été conçue pour mettre le feu aux poudres dans le ventre des Kurdes, et non pour passer l’examen par les pairs. Sur ce point, le mouvement des femmes est certainement parvenu à ses fins.
Il est donc approprié que Dirik consacre dix fois plus de pages à la « pratique » qu’à la « théorie ». Le mouvement des femmes kurdes a remporté des succès antérieurs en organisant les femmes dans les quartiers kurdes, les zones rurales et les camps de réfugiés à travers les territoires kurdes qui font actuellement partie de la Turquie, de l’Irak, de la Syrie et de l’Iran. Mais c’est dans le NES que le mouvement des femmes a joué un rôle de premier plan dans la défaite de DAECH et l’expansion d’un système de gouvernance municipale nominalement décentralisé qui englobe maintenant des millions de résidents, dont la majorité sont des Arabes, y compris de nombreuses communautés qui ont à la fois souffert de DAECH et sympathisé avec lui. En tant que tel, le statut de cette région en tant que site de la « mise en œuvre pratique » de masse des nobles idéaux du mouvement des femmes est ambigu, un processus qui apporte avec lui à la fois de grands défis et de grandes opportunités.
L’Administration autonome de la Syrie du Nord et de l’Est (AANES), dirigée par les Kurdes, suit une philosophie politique connue sous le nom de « confédéralisme démocratique », basée sur trois principes issus de la pensée d’Öcalan : la démocratie directe, l’écologie et l’autonomie des femmes. Bien que ces trois principes soient interdépendants, il est évident que le « pilier » des femmes est le plus solide. La dépendance continue à l’égard des revenus du marché noir du pétrole a empêché toute transition écologique sérieuse, tandis que la dévolution du pouvoir de décision politique reste partielle. Les communautés locales ont leur mot à dire sur la fourniture de services et participent activement aux mécanismes de justice réparatrice, mais dans le contexte des attaques permanentes de la Turquie, de l’insurrection de DAECH et de la pauvreté endémique due à la guerre et à l’isolement de la région par rapport au monde extérieur, la stratégie militaire et diplomatique est nécessairement dirigée par un cadre essentiellement kurde.
La « révolution des femmes » est pourtant évidente. Comme tout visiteur de la région le constatera, les femmes sont en effet partout, organisant des réunions communautaires, participant à des programmes d’éducation et jouant bien sûr un rôle militaire de premier plan. Même dans les régions récemment libérées DAECH, les « Maisons des femmes », qui permettent de résoudre les conflits sociaux sans effusion de sang grâce à une médiation menée par des femmes, sont parmi les premiers projets à prendre racine, même face aux bombardements réguliers de DAECH – et obtiennent plus d’importance et de succès que les communes au niveau du village destinées à fonctionner comme les éléments constitutifs du système de démocratie directe.
Sur le plan social, les femmes continuent bien sûr d’être confinées à la maison, de subir des mariages précoces, des crimes d’honneur et tous les autres pièges du patriarcat régional. De nombreux hommes occupant une position dans les structures politiques de l’AANES sont prêts à défendre du bout des lèvres l’autonomie des femmes, tout en poussant en privé leurs filles à se marier au moment opportun. Mais c’est justement parce que les femmes continuent à être confrontées à de telles difficultés qu’elles sont si nombreuses à avoir saisi la « révolution » à bras-le-corps. Outre l’inversion totale du statut de l’identité kurde, c’est l’essor de l’organisation politique, de l’action sociale et de l’activité culturelle menée par les femmes qui donne à la lente transformation du NES le goût de la révolution.
L’exposé de Dirik sur ces réalisations est intelligent et évite les clichés. Par exemple, la région est connue pour son système de « coprésidence », selon lequel chaque poste public est occupé par un homme et une femme. Comme elle le fait remarquer à juste titre, les critiques qui prétendent que ce système est simplement « symbolique » ne tiennent pas compte de l’essentiel : les symboles eux-mêmes ont un pouvoir, et le système oblige les hommes à écouter les points de vue des femmes dans ce qu’elle appelle une « méthode pédagogique anti-autoritaire pour la démocratisation interne ».
Dans les communautés musulmanes très conservatrices, ces démarches sont elles-mêmes révolutionnaires. Même si une minorité relative de femmes a relevé le défi de promouvoir l’éducation des femmes et l’autodétermination politique dans ces communautés, cela ne délégitime pas les réalisations de ces femmes, comme certains observateurs le suggèrent en traçant une fausse binaire entre les participants actifs à la révolution et les « gens ordinaires » représentés comme plus méfiants à l’égard de l’autonomie des femmes. Après tout, ces participantes volontaires sont nées et ont grandi dans les mêmes communautés ordinaires.
Plus généralement, Dirik affirme que l’autonomie des femmes dans la région sera nécessairement différente du féminisme occidental. Dans son propre compte rendu de la révolution du Rojava, Thomas Schmidinger établit une distinction similaire, affirmant que l’ « autonomie » que la région considère comme son objectif politique est une autonomie « collective » plutôt qu’ « individuelle ». L’objectif n’a jamais été de remplacer les normes conservatrices et tribales par la liberté individuelle de devenir (par exemple) une patronne aux mœurs légères, mais d’accorder aux femmes le pouvoir d’aborder les questions féminines entre elles, en tant qu’unité autonome, et de parler d’une voix collective puissante sur les questions qui les concernent.
En conséquence, le processus révolutionnaire débouche régulièrement sur des décisions, des positions et des compromis qui sont déstabilisants pour le regard occidental. Par exemple, sous le fardeau d’être vilipendées comme des « maisons du divorce » suspectes, les femmes travaillant dans les « maisons des femmes » sont plus susceptibles que leurs homologues occidentales de conseiller aux femmes mariées victimes d’abus de retourner au foyer. Mais quitter le foyer au Moyen-Orient a un coût encore plus élevé que dans d’autres parties du monde, alors que d’un autre côté, la pression sociale et la honte peuvent être exercées plus efficacement sur les hommes, faisant de l’intervention communautaire une véritable alternative. De nombreuses femmes sont en mesure de fuir leur foyer, et la région a connu des centaines de divorces après la légalisation de la procédure en 2012 : mais parfois, une solution communautaire est plus appropriée.
Il ne s’agit pas d’une carte de sortie de prison, bien sûr, et Dirik n’est pas à l’abri de valoriser des aspects de la révolution qui mériteraient un examen plus critique. Si elle affirme que le « mouvement encourage des formes communautaires solidaires d’organisation de la garde des enfants, de la production, etc. », il est difficile de voir en quoi cela marque une rupture révolutionnaire par rapport aux modes préexistants de garde communautaire des enfants, étant donné que les femmes continuent d’assumer la quasi-totalité des rôles de garde d’enfants avec peu de soutien formel de la part de l’AANES.
Pour prendre un autre exemple, lorsqu’il décrit la création inévitable d’une force de sécurité interne (les Asayish) dans la région pour faire face à la menace sérieuse posée par les cellules dormantes d’ISIS et les attaques soutenues par les régimes turc et syrien, l’auteur est prêt à prendre pour argent comptant l’affirmation d’une femme membre des Asayish selon laquelle elle aurait « surmonté la personnalité autoritaire créée par le régime [syrien] », créant ainsi une institution nouvelle et plus progressiste. Certes, les Asayish ne sont en rien comparables aux forces de sécurité syriennes brutales, mais les affirmations selon lesquelles cette unité de sécurité interne est fondamentalement différente d’une force de police sont exagérées. Il est louable que les Asayish déploient des habitants dans leurs propres zones, réduisant ainsi les tensions intracommunautaires, mais leur présence n’est pas ressentie de la même manière dans les régions à majorité arabe que dans les régions kurdes. Ceux qui s’opposent à leur présence sont souvent des sympathisants de DAECH, voire des partisans actifs : quoi qu’il en soit, la présence inévitable des Asayish dans ces régions est clairement ressentie comme une force de police et fonctionne comme telle. Plutôt que de minimiser les compromis auxquels la révolution a été contrainte, les comptes rendus sympathiques de la révolution du Rojava peuvent et doivent reconnaître les pressions extrêmes auxquelles la région est soumise.
Il est donc intéressant de voir où le mouvement des femmes a choisi de pousser à la réforme ou à la révolution, et où il a fait des compromis. C’est ainsi, par exemple, que la polygamie est carrément interdite dans les régions kurdes, mais toujours tolérée – bien que désapprouvée – dans les régions arabes récemment libérées de DAECH. Lors d’un incident survenu en 2020, il a été interdit aux femmes de travailler dans les cafés de Raqqa, l’ancienne capitale de DAECH, après les heures de travail, tout comme la consommation publique d’alcool, ce qui a suscité des questions perplexes de la part de certains journalistes occidentaux. Mais lorsque j’ai parlé à des militantes de la cause des femmes dans la ville, elles ont expliqué que ces mesures visaient spécifiquement les cafés servant de couverture à la prostitution, dans le cadre d’efforts plus larges pour lutter contre l’exploitation des réfugiés de guerre appauvris, le bureau local des femmes s’efforçant de trouver d’autres formes d’emploi. Ce n’est peut-être pas la solution que certaines féministes occidentales espèrent, mais dans le contexte syrien, il s’agit d’une mesure valable et réfléchie visant à protéger les femmes.
Dirik prévient que « l’espace entre le marteau et l’enclume peut ouvrir la voie à des lignes de pensée qui s’appuient sur le soutien d’un État extérieur pour protéger temporairement des acquis, généralement à un coût élevé ». C’est tout à fait le cas dans la région de NES, qui est contrainte de nouer des alliances et des relations difficiles avec les États-Unis, la Russie et les autorités centrales syriennes. Mais le fait d’opérer dans cet espace troublé pousse également le mouvement kurde à des compromis productifs, l’obligeant à comprendre et à gérer les tensions entre son engagement clair en faveur de la libération des femmes, d’une part, et l’autodétermination de la communauté, d’autre part.
Souvent, la libération des femmes a été privilégiée, même au risque de provoquer les hommes au pouvoir. D’une part, selon Dirik, les « approches libérales, pragmatiques et centralistes » sont considérées comme masculines, alors que le mouvement des femmes a fait pression pour des approches plus révolutionnaires et transformatrices tout au long de l’histoire du mouvement kurde. Mais également, comme l’écrit l’auteur en référence à l’organisation kurde à double pouvoir en Turquie, les organisatrices politiques féminines sont plus étroitement ancrées dans la société civile et sont donc en mesure de démontrer que « de nombreuses femmes sont favorables à la fin de la discrimination fondée sur le sexe, du mariage des enfants, de l’échange de fiancées, de la polygamie et du prix de la fiancée ». Ces objectifs, tous régulièrement mis en œuvre par le mouvement kurde en dépit d’une forte opposition sociale, ne sont ni extrêmes ni invraisemblables. Au contraire, l’idée que « la société n’accepterait pas le changement [est] une prophétie qui se réalise d’elle-même ».
Le défi auquel le mouvement est confronté aujourd’hui est de refuser l’hypothèse – contraire à la valorisation audacieuse de la « fraternité des peuples » par l’AANES, mais couramment entendue en privé – selon laquelle les régions arabes rétives sont trop arriérées, cloisonnées ou islamiques pour accepter une transformation sociale menée par les femmes. Bien que les hommes kurdes soient aussi régulièrement mis en cause pour leurs normes patriarcales, le mouvement des femmes kurdes lui-même n’est pas à l’abri de l’idéalisation de la féminité kurde. Dirik met en garde contre le fait que les révolutionnaires kurdes de sexe masculin établissent une distinction entre les femmes « révolutionnaires/libérées » et les femmes « classiques/traditionnelles » qui restent confinées dans des rôles sociaux traditionnels. Mais le mouvement des femmes lui-même joue également un rôle dans le maintien de ce binaire, en adoptant parfois par défaut un idéal de femme kurde émancipée, les cadres révolutionnaires exprimant une frustration (compréhensible) face au patriarcat profondément enraciné dans les régions arabes.
C’est plutôt la lutte audacieuse et continue pour mettre en œuvre les idéaux libérateurs du mouvement kurde dans les régions conservatrices et tribales qui peut pousser le mouvement à atteindre un succès durable et la stabilité au-delà des terres kurdes, dans le cadre de sa transition actuelle de force de guérilla à acteur quasi-étatique. Si le mouvement souhaite réellement offrir une alternative « paradigmatique » au Moyen-Orient, il doit continuer à relever les défis pour atteindre ces communautés. Ce sont les femmes qui se sont montrées les plus sensibles à leur message et, à mesure que le programme d’éducation d’AANES, qui met l’accent sur les droits et l’autonomie des femmes, atteindra progressivement ces régions, le changement continuera à se propager.
Ainsi, Dirik affirme que la question de savoir si la « révolution » au Rojava est un succès ou un échec, ou même une révolution tout court, n’est pas pertinente. Au contraire, le processus partiel et imparfait de transformation sociale dans la région fait partie d’un mouvement historique plus large qui a commencé avant et qui continuera après. Son propre travail devrait être lu dans le même esprit : comme une contribution vitale à la conversation dynamique et continue autour d’un mouvement qui mérite à la fois une attention plus sérieuse et un examen plus critique de la part de ses sympathisants.
Dans son introduction, Dirik écrit que les Kurdes, les femmes et les mouvements (révolutionnaires, politiques) sont tous des phénomènes qui ont été opprimés tout au long de l’histoire. Dans ses efforts pour surmonter la répression, le mouvement des femmes kurdes a certainement obtenu des résultats révolutionnaires pour ces classes interdépendantes. On pourrait dire qu’un certain nombre de défis majeurs auxquels le mouvement des femmes kurdes est confronté se situent maintenant dans la direction opposée : atteindre les communautés arabes, changer l’attitude des hommes méfiants et conservateurs, et réussir la transition vers une gouvernance quasi-étatique.
Par Matthew Broomfield, journaliste, critique, traducteur et poète britannique indépendant spécialisé dans la question kurde
Version anglaise sur The Markaz Review: Can the Kurdish Women’s Movement Transform the Middle East?
